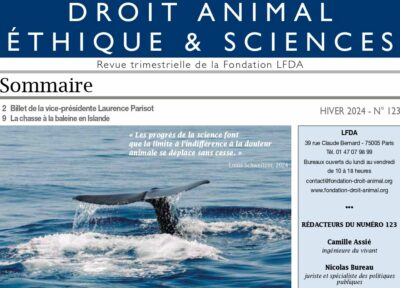Le 22 novembre 2023, le Tribunal de l’Union européenne (UE), juridiction de première instance de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), rend un arrêt semblant fragiliser l’interdiction des tests sur animaux prévue par le règlement dit « cosmétiques ». Celui-ci énonce en son article 18 l’interdiction de tester des ingrédients ou des produits finis sur des animaux pour prouver leur sécurité, ainsi que l’interdiction de vendre en Europe des produits contenant des ingrédients ayant été testés sur des animaux.
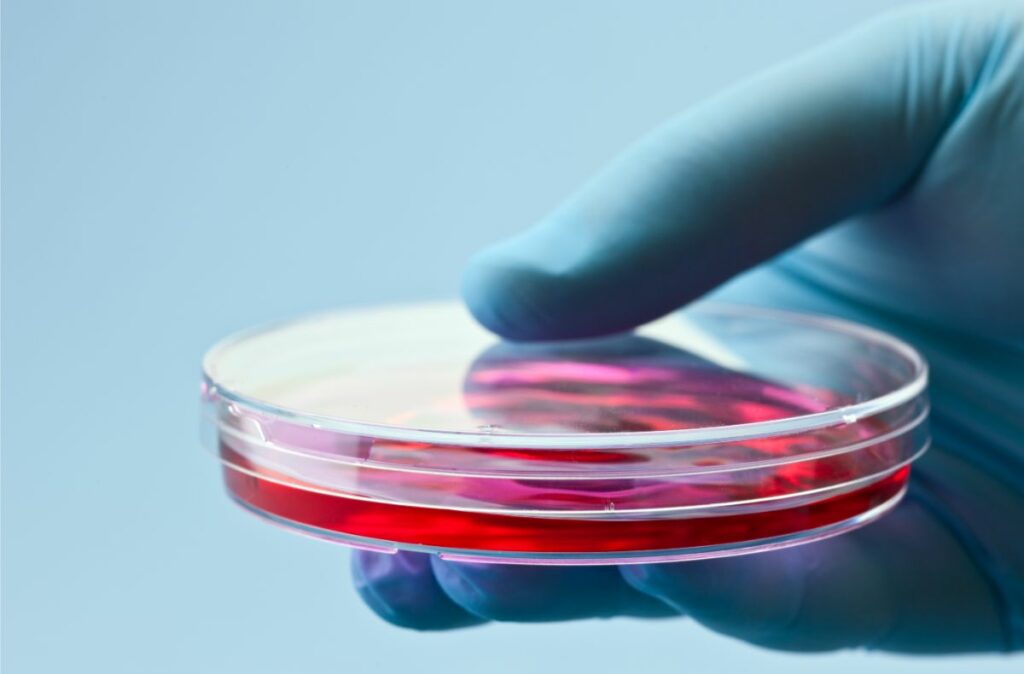
Symrise contre ECHA sur les tests sur animaux en cosmétique
Cet arrêt opposait l’entreprise Symrise AG à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) qui exigeait que des tests sur animaux soient effectués sur certains ingrédients utilisés par Symrise, conformément au règlement Reach. Symrise s’est opposée à cette décision et a saisi le Tribunal de l’UE afin d’en demander l’annulation. Le règlement Reach (règlement n° 1907/2006, entré en vigueur en 2007), encadre l’utilisation et la fabrication des substances chimiques dans l’UE afin de protéger la santé humaine et l’environnement : « il s’agit de recenser, d’évaluer et de contrôler les substances chimiques fabriquées, importées, mises sur le marché européen ». Cette décision vient questionner la relation entre ces deux règlements ainsi que leur influence mutuelle.
Le Tribunal rejette le recours de Symrise et valide la décision de l’ECHA, considérant que les normes du règlement cosmétiques et du règlement Reach ne sont pas incompatibles, mais complémentaires.
Une décision qui précise la portée du règlement cosmétiques
Dans sa décision, le Tribunal souligne que les règlements Reach et cosmétiques poursuivent un but commun : la protection des êtres humains. Les deux normes semblent cohérentes et compatibles et remplissent cet objectif final différemment : quand le règlement cosmétiques vient protéger les consommateurs finaux, le règlement Reach vise à protéger les travailleurs (« produisant les produits cosmétiques ») et l’environnement.
Le règlement cosmétiques interdit en son article 18 de tester sur des animaux et de commercialiser des produits cosmétiques testés sur des animaux. Mais cette interdiction n’est valable que si ces tests sont utilisés pour prouver la sécurité d’un produit cosmétique dans son rapport sur la sécurité (article 10 du règlement). Cette interdiction ne s’étend donc pas aux tests requis par d’autres réglementations, comme Reach, notamment pour protéger les travailleurs ou l’environnement. Dans son arrêt, le Tribunal adopte une interprétation restrictive de cette disposition. Comme l’explique le Tribunal dans son arrêt (paragraphe 92), « […] le déclarant d’une substance utilisée uniquement dans des produits cosmétiques n’est pas exempté, au titre de la section 3 de l’annexe XI du règlement Reach, de fournir les informations standards à l’égard des propriétés intrinsèques de cette substance. Cette constatation découle de la circonstance selon laquelle les risques pour la santé humaine couverts par le règlement cosmétiques et le règlement Reach ne sont pas identiques. Le règlement cosmétiques vise les risques pour la santé humaine qui résultent des utilisations finales d’un produit cosmétique qui contient une substance alors que le règlement Reach vise les risques pour la santé humaine relatifs à l’ensemble des expositions tout au long du cycle de vie de la substance, y compris, notamment, les risques auxquels sont exposés les travailleurs. »
Donc l’interdiction n’est pas absolue, l’expérimentation animale est autorisée dans certains cas et même si cela concerne des produits ou ingrédients cosmétiques : « […] la chambre de recours a relevé le fait que le règlement cosmétiques n’interdisait pas au déclarant d’une substance utilisée, exclusivement ou parmi d’autres usages, comme ingrédient d’un produit cosmétique de réaliser des tests sur les animaux vertébrés aux fins de satisfaire aux informations requises pour l’enregistrement de ladite substance par le règlement Reach » ( paragraphe 62 de l’arrêt).
De ce fait, ces tests ne sont pas incompatibles avec l’article 18 du règlement cosmétiques, en ce sens qu’ils ne sont pas expressément visés par la disposition. Ils sont donc autorisés dès lors qu’un risque pour la population ou l’environnement existe et qu’aucune méthode alternative ne permet d’en prouver l’innocuité.
Une décision aux conséquences préoccupantes pour les animaux ?
Si la position du Tribunal de l’UE permet effectivement d’assurer une protection plus large que celle des simples consommateurs finaux, il semblerait aussi qu’elle puisse ouvrir des failles dans le cadre juridique de la protection animale.
Néanmoins, notons que le Tribunal rappelle expressément que les entreprises ont toujours la possibilité d’utiliser des méthodes non animales afin de se substituer à l’expérimentation animale. Encore faut-il qu’elles existent pour l’ingrédient et soient validées.
Lire aussi : Existe-t-il une liste des méthodes alternatives à l’expérimentation animale ?
En l’espèce, Symrise aurait pu démontrer que les travailleurs n’étaient pas exposés, voire très peu exposés à la substance et qu’ils disposaient de méthodes substitutives pour évaluer les risques. Malheureusement, l’entreprise n’a pas été en mesure de démontrer l’exécution de ces deux obligations, fondant de ce fait la demande de l’ECHA.
Cet arrêt confirme donc que des exceptions à l’interdiction des tests sur les animaux sont possibles, notamment par le truchement du règlement Reach. Cette interprétation jurisprudentielle a suscité des craintes de la part des ONG engagées en faveur de la cause animale. Celles-ci redoutent notamment un affaiblissement de la législation qui protégeait depuis 2013 les animaux en interdisant l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques au sein de l’Union européenne.
Néanmoins, au regard de cet arrêt, il ne semble pas que cette décision remette en cause l’interdiction des tests de produits sur les animaux. Elle s’inscrit plutôt dans une décision spécifique portant sur un cas particulier où certaines exigences légales n’ont pas pu être respectées. Comme l’a souligné le Tribunal, il appartenait à Symrise de proposer des méthodes de tests alternatives, ce qui soulève la question de leur rareté et de leur importance fondamentale dans la protection des animaux.
Expérimentation animale et méthodes alternatives
L’expérimentation animale est une pratique qui soulève de nombreuses problématiques, tant éthiques que scientifiques et économiques. Les expériences faites sur les animaux sont, dans leur définition même, source d’angoisse ou de douleur (article 3 de la directive 2010/63/UE). Plus de la moitié des procédures appartiennent à une classe de gravité allant de « modérée » à « sévère », et les conditions de vie dans les laboratoires sont souvent inadaptées aux besoins des animaux. Cela engendre encore plus de détresse physique et psychologique pour les plus de 2 millions d’animaux concernés chaque année en France, et 8 millions en Europe.
De plus, la fiabilité des résultats de certaines de ces expérimentations est également remise en question. En effet, les différences biologiques entre les humains et les autres animaux ne garantissent pas toujours la pertinence de ces tests en ce qu’un résultat obtenu chez un animal n’est pas toujours prédictif du résultat chez l’humain. Le taux de prédictibilité est parfois assez faible, notamment en raison de ces différences inter-espèces, mais aussi du stress et de la détresse des animaux, qui peuvent fausser les résultats.
Il existe pourtant des alternatives non animales pouvant être développées, telles que les expériences in vitro, la modélisation informatique (in silico), la recherche avec l’aide d’humains volontaires ou encore les simulateurs de patient humain. Certaines ont démontré leur efficacité, d’autres nécessitent encore d’être validées.
Évolution du cadre légal : entre sécurité humaine et protection animale
En définitive, cet arrêt vient mettre en lumière le conflit persistant entre respect des exigences de sécurité pour la population humaine, et la prise en compte du bien-être animal.
En rejetant la demande de Symrise et en validant la décision de l’ECHA, le Tribunal de l’UE fait perpétuer un cadre juridique qui continue d’imposer l’expérimentation animale aux entreprises, malgré des pratiques controversées. Le Tribunal vient aussi rappeler aux entreprises qu’elles sont tenues de se conformer au règlement Reach en matière de substances chimiques, notamment pour la sécurité des travailleurs manipulant ces substances, et cela même si elles opèrent dans le domaine du cosmétique.
Toutefois, cette décision souligne également l’urgence d’accélérer le développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale, afin d’enfin adopter un régime plus éthique : protecteur des humains, des animaux et de l’environnement. Il semble donc impératif que les institutions (à l’image du centre FC3R, financé par l’État, et dont le conseil d’orientation et de réflexion est présidé par Louis Schweitzer, président de la LFDA) et la communauté scientifique redoublent d’efforts afin de promouvoir de nouvelles méthodes qui permettront de limiter le plus possible le recours à l’expérimentation animale et d’assurer un avenir meilleur aux animaux de laboratoire.
Héloïse Madjeri