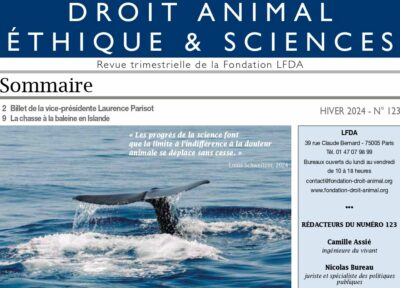Le mathématicien Cédric Villani a récemment intégré le comité d’honneur de la LFDA. Lauréat de la prestigieuse médaille Fields mais aussi ancien député, il s’est fait remarquer lors de son mandat pour son investissement en faveur de la cause animale. Dans cet entretien, il retrace pour nous son parcours personnel et politique et partage sa vision de l’articulation entre la technologie et l’éthique animale.
Vous êtes d’abord un éminent mathématicien, comment votre parcours vous a-t-il mené à vous investir en faveur de la cause animale ?

Cédric Villani : Mon empathie pour la cause animale remonte à très longtemps. Je dirais même que le sujet animal en tant que sujet intellectuel a toujours été mon favori. Quand j’étais gamin, j’avais ces petites fiches thématiques détaillant chaque espèce animale dans l’ordre alphabétique. J’avais ce bouquin, La vie sur Terre, tout à la gloire de Charles Darwin, ou encore ce livre illustré de Walt Disney, Désert vivant. Tout cela était tellement bien imprégné en moi que, des années plus tard, j’ai donné pour titre Théorème vivant à mon ouvrage autobiographique sur la recherche mathématique, en partie en résonance avec ce livre. Je me disais que la mathématique est comme le désert : on croit que c’est aride et sans vie, mais si on sait où regarder c’est chatoyant, plein de couleurs et de poésie. Adolescent, je me suis passionné pour la cause de la conservation des espèces. Les paléontologues Robert Bakker (Le Ptérodactyle rose) et Stephen Jay Gould (Le Pouce du panda, La Foire aux dinosaures, La Vie est belle, etc.) faisaient partie de mes héros. Je vous cite ces références pêle-mêle qui parlent du vivant d’aujourd’hui et de la paléontologie parce que j’ai toujours considéré cela comme intégré dans un grand tout. C’est à mon arrivée à l’Assemblée nationale en 2017 que la conjonction s’est faite. Je me suis inscrit au groupe d’études « Condition animale » et ça a été une révélation : l’animal en tant que question politique. Ce fut une vraie bascule, je m’y suis plongé, dans mon identité publique comme dans ma chair, si je puis dire. De fil en aiguille, au cours de ce mandat, j’ai lu beaucoup d’ouvrages traitant soit directement de causes politiques, soit de sujets en lien avec ces dernières. C’est comme ça que je me suis retrouvé à travailler le sujet animal, dont j’étais référent pour mon groupe politique. Je l’ai abordé comme un intellectuel, aussi bien par l’angle philosophique que politique, social, sociologique, économique, etc.
Vous avez été initiateur, en 2020, d’une importante proposition de loi contre la souffrance animale, qui n’a malheureusement pas été adoptée. Pourtant, un an plus tard, un texte similaire a été soutenu par le gouvernement et s’est traduit par de grandes avancées pour les animaux. Quelles leçons tirez-vous de cette expérience parlementaire et de cette séquence politique ?
C. V. : J’ai trouvé cette thématique passionnante. Le sujet animal en politique, c’est toute une affaire. Parmi les personnes qui s’y intéressent et qui sont inscrites au groupe d’étude dédié, certains sont là par intérêt politique parce qu’ils entendent bien faire avancer leur carrière dans la question animale, d’autres qui sont là uniquement pour donner une excuse parce qu’ils vont voter les pires lois possibles à l’encontre des animaux. Puis, quelques-uns sont des gens sincères et extrêmement motivés. J’ai un souvenir ému des sympathies et amitiés que j’ai pu nouer avec des parlementaires issus de différents bords politiques, avec des positions parfois à contre-courant des programmes de leur parti. J’ai aussi choisi de siéger à la commission des affaires économiques parce que, quand il s’agit de transformer la société, c’est l’endroit où l’on trouve les blocages les plus importants. C’est dans ce cadre que j’ai porté cette proposition de loi extrêmement ambitieuse. J’ai vite compris que les organisations telles que la LFDA avaient un savoir technique et un savoir-faire précieux par rapport à la réglementation et la jurisprudence, et j’ai pu travailler avec elles.
Cette proposition de loi reste globalement la plus ambitieuse jamais portée sur le sujet. Elle abordait des questions dont certaines étaient presque mûres, parce que le débat public était favorable ou parce qu’il y avait un essoufflement économique (la fourrure, les animaux sauvages dans les cirques et delphinariums, etc.), et d’autres qui ne l’étaient pas du tout, comme celles relatives à l’élevage (la fin des cages, la sortie progressive de l’élevage intensif). Entre les deux, il y avait le sujet des chasses cruelles (à courre, sous terre, à la glu, etc.). Finalement, plus le sujet touchait un nombre important d’animaux (plusieurs milliards en ce qui concerne l’élevage français) et avait un impact économique, plus il était difficile, et inversement. Pourtant, les conditions de vie et de mort des animaux d’élevage sont les plus dures.
Dès le début, il était clair que ma proposition de loi serait repoussée sans pitié. Le jour où elle a été débattue dans l’hémicycle, nous n’avons même pas pu voter l’article 1 car elle a été barrée par l’habituelle manœuvre dilatoire qui consiste à vous submerger de propositions d’amendements, de façon à ne simplement pas étudier le texte. Pourtant, le bilan fut loin d’être nul. D’abord, ça a été un débat intense. Un sujet politique, ce n’est pas seulement des lois et des règles, c’est aussi la façon dont vous le portez dans le débat public. L’un et l’autre sont indispensables. Si l’opinion publique est en décalage avec la loi, la loi changera tôt ou tard. On est donc parvenu à passer une certaine étape dans le débat public. Des choses ont pu être entendues, de sorte que ça a préparé le terrain pour la loi contre la maltraitance animale qui a été adoptée un an plus tard.
Lire aussi : Proposition de loi contre la maltraitance animale : députés et sénateurs se mettent d’accord
Votre formation scientifique a-t-elle influencé votre approche du sujet animal ?
C. V. : Quand vous êtes plongé dans le bain politique, vous comprenez rapidement que, ce qui compte, ce n’est pas tellement la science et la cohérence, mais l’énergie et le cœur. C’est la façon dont vous arrivez à faire vibrer le sujet. La base scientifique sous-jacente est importante pour moi, intellectuellement, pour être sûr de mon affaire et pour sentir la connexion. Mais ce n’est pas ça qui fait gagner la bataille politique. Elle se gagne par la ténacité et la force de conviction, la façon dont on arrive à faire ressentir l’énergie. Pour moi, ces deux facettes sont indissociables. Je ne peux pas être bon dans un débat, pour porter une cause, si je ne suis pas aligné entre la partie émotive et la partie réfléchie.
Parmi vos domaines d’expertise, celui de l’intelligence artificielle est plus que jamais d’actualité. Des outils dédiés à l’élevage commencent à voir le jour. Peuvent-ils représenter une véritable révolution pour le bien-être animal ?
C. V. : L’intelligence artificielle pour les diagnostics et analyses est un sujet transversal. Il y a toutes sortes de cas d’usage pour lesquels elle peut aider au bien-être des animaux d’élevage. Ça peut être une alerte santé, la détection de signaux de stress, de comportements anormaux, etc., mesurés avec des caméras ou des analyses biologiques. On peut dire que c’est un outil pour améliorer la condition des animaux. À l’échelle de la société, politiquement et dans le débat public, c’est en réalité davantage du techwashing. Finalement, ça détourne le débat du vrai sujet qui est qu’un animal emprisonné est malheureux, quoi que vous fassiez. Ce n’est pas parce qu’un collier connecté ou une caméra pointée sur vous détectent votre détresse que vous allez vous sentir soulagé d’être enfermé ou que ça va changer le fait que vous menez une existence misérable dans des conditions inadaptées. Il ne faut donc surtout pas utiliser l’intelligence artificielle comme une excuse pour ne pas agir. Ce débat sur la place de l’objet connecté et de l’algorithme sera bientôt sur la table de l’Ordre des vétérinaires, dont j’ai siégé au comité d’éthique présidé par Louis Schweitzer. La sphère des vétérinaires a d’ailleurs toujours été l’articulation passionnante entre la technique et la politique. En ce qui concerne les alternatives à l’expérimentation animale, les progrès de l’algorithmique nous laissent également espérer des résultats plus fiables que ceux obtenus aujourd’hui sur des organismes vivants différents de l’organisme humain.
Quelles lectures ont marqué votre réflexion sur les enjeux de la cause animale ?
C. V. : Je suis un intellectuel et mon rapport au monde est construit au départ par les ouvrages, même s’il est suivi de la mise en pratique. L’ouvrage qui a été extrêmement marquant et qui a initié toute ma réflexion sur la question de l’animal d’élevage est Animal Machines de Ruth Harrison. Publié en 1964, il n’a jamais été traduit en français. C’est révélateur de la façon dont la France se saisit du sujet et est toujours en retard par rapport au monde anglo-saxon. L’ouvrage aborde le sujet par tous les canaux, à la fois éthiques, culturels, économiques, sans oublier l’enquête scientifique qui documente la naissance de l’élevage intensif et du concept de ferme-usine. Harrison a été jusqu’à expérimenter sur elle-même les deux méthodes classiques de mise à mort sur les animaux – la suffocation et l’électricité – pour avoir une idée de ce qu’on ressentait. D’autres ouvrages et personnalités m’ont beaucoup inspiré : l’éthologue Jane Goodall, le biologiste Yves Christen (L’Animal est-il une personne ?), les grands classiques que sont les philosophes Peter Singer et Élisabeth de Fontenay. Dans les grandes claques, il y a les ouvrages du biologiste Marc Bekoff qui a commencé sa carrière scientifique dans l’expérimentation animale. Il décrit de l’intérieur ce qu’il a ressenti et il s’attache à montrer tout ce qu’on peut trouver de sentiments, d’émotions, d’entraide et d’empathie chez les animaux. Puis, les ouvrages de Darwin, qui n’a pas seulement travaillé sur l’évolution des espèces mais aussi sur les émotions animales. Il a été président de la Société royale protectrice des animaux (RSPCA), été auditionné par le Parlement sur les questions de l’expérimentation animale, a pris position contre la vivisection, comme on disait à l’époque. Au fond, une grande carrière très inspirante. Élisée Reclus, scientifique extraordinaire du XIXe siècle qui a écrit la plus grande géographie de toute notre histoire, mais aussi anarchiste et militant animaliste résolu qui parle de l’empathie pour les autres animaux avec des accents que ne renieraient pas les auteurs antispécistes d’aujourd’hui. Puis, s’il n’y avait qu’un documentaire à citer ce serait La Sagesse de la pieuvre. À lui seul, ce film m’a fait arrêter de manger des céphalopodes. C’est, pour moi, le modèle le plus impressionnant de découverte d’un autre monde, entre individus aussi différents que mammifères et céphalopodes, qui montre à quel point l’empathie existe et est possible même entre des branches aussi éloignées dans l’arbre du vivant.
Propos recueillis par Léa Le Faucheur