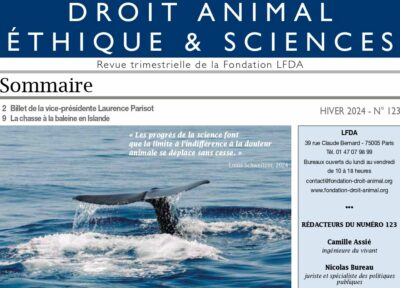Compte rendu de lecture
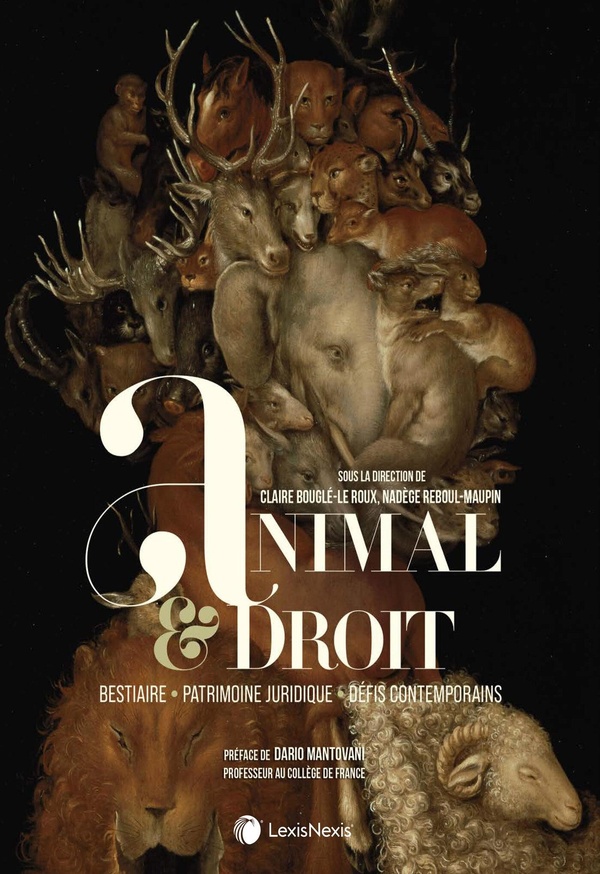
L’ouvrage Animal & Droit rassemble des contributions d’une cinquantaine d’autrices et d’auteurs s’intéressant à la réflexion juridique autour de l’animal.
Les autrices et auteurs présentent diverses thématiques, tantôt contemporaines, tantôt ancrées dans un passé marqué par des échanges multiples entre l’humain et le non-humain, tout en variant les formats d’analyse. Les chapitres s’ouvrent ainsi sur un « bestiaire » illustratif et sont étoffés par un ensemble de contributions et d’entretiens, chacun abordant l’animal sous des angles spécifiques : objet d’images, d’obligations ou de droits, sujet réifié ou encore être humanisé, sensible ou sacrifié.
En abordant des domaines juridiques variés comme le droit international, la responsabilité, la protection et le droit des biens, l’ouvrage met en lumière la façon dont ces disciplines s’emparent progressivement des questions complexes liées à l’animal pour les intégrer à leur cadre théorique.
Cyrille Dounot, professeur d’histoire du droit à Toulouse raconte la place des insectes dans le droit canonique, donc le droit de l’église catholique. Les insectes sont parfois inclus dans des rituels : lors de la bénédiction des cierges, par exemple, il est mentionné le travail des abeilles qui permet d’obtenir la cire utilisée par l’église. La juridiction ecclésiastique a parfois l’occasion, au Moyen Âge, de connaître des procès contre des sangsues ou des papillons.
Lire aussi : Lecture : Une histoire animale du monde – À la recherche du vécu des animaux de l’Antiquité à nos jours
Alice Di Concetto, directrice juridique de l’Institut européen pour le droit de l’animal, nous parle de l’utilisation des animaux à des fins alimentaires et souligne que la transposition française des directives et règlements européens manque d’ambition. En effet, la France s’est contentée de reprendre la législation européenne telle quelle, alors même que le droit français impose de prendre en compte les intérêts des animaux lors de l’adoption des normes juridiques.
Thierry Vignal, professeur de droit privé à Cergy-Pontoise, nous parle de la « curiosité juridique » que représente la corrida, en examinant par exemple la jurisprudence avec un angle historique. On apprend que dans les années 1960, une divergence point entre différentes juridictions quant à la notion de « tradition locale ininterrompue », précision juridique servant à légitimer l’exception que représente la corrida dans certaines régions.
François-Xavier Roux-Demare, doyen honoraire de l’Université de Bretagne occidentale, récipiendaire 2022 du Prix de Droit de la LFDA, s’interroge sur l’avenir d’une reconnaissance juridique de la dignité animale, en analysant l’approche anthropocentrée de la protection animale. La consécration du concept de dignité animale garantirait ainsi le respect des animaux en tant qu’individus à part entière, en affirmant que les animaux possèdent une valeur intrinsèque et non pas seulement une valeur en fonction de notre perception.
Clara Bernard-Xémard, maître de conférences en droit privé à l’université de Paris-Saclay, explore la place de l’animal de compagnie dans la séparation du couple. Si l’animal de compagnie a longtemps été considéré comme un simple bien par la justice lors des règlements de divorce, il est aujourd’hui intéressant de constater que de plus en plus de décisions envisagent l’animal comme faisant partie intégrante de la cellule familiale et prennent ainsi des mesures adaptées aux situations de séparations, telles que des possibilités de garde alternée, ou encore la priorisation du lien d’affection sur le droit de propriété de l’un ou l’autre époux.
Le recueil s’appuie sur un riche patrimoine intellectuel pour proposer une perspective globale, où se mêlent considérations historiques et enjeux contemporains. Son ambition est d’éclairer la façon dont se construit, au fil des siècles, la relation entre les humains et les animaux, en explorant notamment les représentations artistiques et juridiques, ainsi que la place de l’animal dans l’environnement et dans les activités économiques.
Nicolas Bureau & Héloïse Madjeri