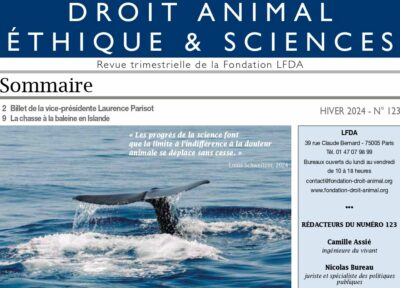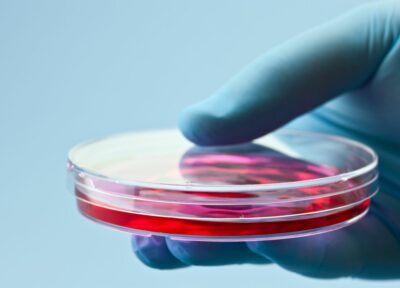Ces dernières années, le Mexique a connu des avancées législatives majeures en matière de protection animale, marquant un tournant éthique et culturel dans la manière dont les animaux sont perçus et traités. Ces progrès culminent avec l’inscription récente de la protection des animaux dans la Constitution mexicaine, une première dans l’histoire du pays. Cette réforme constitutionnelle, signée par la présidente Claudia Sheinbaum le 2 décembre 2024, représente une étape décisive pour le mouvement des droits des animaux au Mexique et pourrait servir de modèle pour d’autres pays, notamment en Amérique latine.

À l’origine de cette réforme se trouve une vague sans précédent portée par des collectifs animalistes, des juristes engagés et des scientifiques. Le projet, initié sous l’ancien président López Obrador en février 2024, a suivi un parcours législatif exigeant : vote à la Chambre des députés (majorité des deux tiers), approbation unanime du Sénat, puis ratification par 26 États fédérés en à peine huit jours. Ce marathon politique révèle une prise de conscience transversale, transcendant les clivages partisans traditionnels.
Un contexte national favorable
Le Mexique a progressivement renforcé sa législation sur le bien-être animal au cours des dernières années. En 2017, la Constitution de la ville de Mexico a reconnu les animaux comme des êtres sensibles, un changement symbolique fort. La même année, le gouvernement fédéral a criminalisé les combats de chiens. En 2021, le Mexique est devenu le premier pays d’Amérique du Nord à interdire les tests cosmétiques sur les animaux. En 2022, l’État de Tlaxcala est devenu le 31e État à inclure des sanctions pour cruauté envers les animaux dans son code pénal local. Enfin, en novembre 2023, l’État d’Oaxaca a adopté sa première loi de protection animale.
Le processus qui a conduit à la réforme constitutionnelle a pris plusieurs années, avec une approche méthodique et persistante. Les mouvements animalistes ont su mobiliser l’opinion publique pour faire pression sur les décideurs politiques. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées, notamment via des pétitions en ligne qui ont recueilli des dizaines de milliers de signatures. Ces initiatives ont montré au législateur que la protection animale était une préoccupation majeure pour les citoyens.
Les organisations ont également utilisé des enquêtes approfondies pour révéler les conditions cruelles dans lesquelles les animaux étaient traités, notamment dans les abattoirs et les fermes industrielles. Ces enquêtes, souvent accompagnées de vidéos et de rapports détaillés, ont servi de preuves tangibles pour justifier la nécessité d’une réforme constitutionnelle. Par exemple, une enquête menée dans plus de 50 abattoirs a non seulement exposé des pratiques cruelles envers les animaux, mais aussi des violations des droits des travailleurs, créant un lien entre la cause animale et des enjeux sociaux plus larges.
Le contexte politique a également joué un rôle clé. L’élection de Claudia Sheinbaum, une présidente sensible aux questions environnementales et animales, a créé une opportunité unique pour faire avancer la cause animale. De plus, la réforme a été intégrée dans un ensemble de 20 réformes constitutionnelles présentées par l’ancien président avant son départ, ce qui a facilité son adoption.
Les mouvements animalistes ont également su créer des alliances avec d’autres causes sociales, comme la défense des droits des travailleurs ou la protection de l’environnement. En montrant que la protection animale était liée à des enjeux plus larges, ils ont élargi leur base de soutien et renforcé leur légitimité.
Lire aussi : L’émergence de l’animal dans la Constitution italienne
La réforme constitutionnelle
La réforme porte sur trois articles de la Constitution mexicaine.
L’article 3 de la Constitution est ainsi modifié : « Les plans et programmes d’études [incluront] la protection de l’environnement, la protection des animaux, entre autres ». (Constitution politique des États-Unis du Mexique, article 3, alinéa 12).
En France, la loi dispose depuis 2021 que « l’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale » (code de l’éducation français, article L312-15).
Au-delà du fait que la loi française n’est pas correctement appliquée parce qu’il a fallu attendre 2024 pour que le bien-être soit enseigné dans les programmes, et seulement en CP, le Mexique va plus loin en ce qu’il rend cette obligation constitutionnelle et l’étend à d’autres animaux que les simples animaux de compagnie.
En outre, au sein de son article 4, la Constitution prévoit à présent la disposition suivante : « Il est interdit de maltraiter les animaux. L’État mexicain doit garantir la protection, le traitement idoine, la conservation et les soins des animaux, conformément aux dispositions des lois applicables » (article 4, alinéa 6).
Dans cet article, la Constitution prévoit une obligation négative et plusieurs obligations positives. Une obligation négative met à la charge des autorités de l’État le devoir de s’abstenir d’agir pour ne pas interférer de manière injustifiée avec tel ou tel droit (« il est interdit de »). Une obligation positive met à la charge des autorités de l’État le devoir de prendre des mesures en vue de sauvegarder tel ou tel droit (« l’État doit garantir »).
Bien évidemment, beaucoup de choses se joueront dans la portée donnée à cet article, ainsi qu’à son interprétation : qui est visé par cette obligation négative ? Quels animaux, quels acteurs d’activités sont concernés ? L’examen des débats au Parlement mexicain peut déjà nous éclairer sur l’esprit de la réforme ; la question des corridas en particulier a fait débat et il n’est pas évident que le législateur sera très pressé de mettre fin à cette pratique. De manière plus générale, il semble raisonnable de penser que certaines activités ne seront pas impactées, ou en tout cas que l’on placera le curseur de ce qu’est une « maltraitance » au-dessus des pratiques régulières de ces activités.
Les obligations positives prévues par cet article, quant à elles, ne seront effectives que par les « lois applicables », et c’est donc le législateur qui devra définir comment les mettre en œuvre. On peut dès lors légitimement se dire que le champ d’action du législateur ne sera peut-être pas si contraint que ça par cet article, qui pourra en revanche servir de base lors de discussions sur le bien-être animal, afin de pousser vers le « mieux ».
Enfin, dans l’article 73, alinéa XXIX-G , une nouvelle compétence est confiée au Congrès : « Le Congrès a le pouvoir de promulguer des lois qui établissent la collaboration du gouvernement fédéral, des gouvernements des entités fédérées, des municipalités et, le cas échéant, des circonscriptions territoriales de la ville de Mexico, dans le cadre de leurs compétences respectives, en matière de protection de l’environnement, de préservation et de restauration de l’équilibre écologique, ainsi que de protection et de bien-être des animaux ».
Cette disposition introduit la possibilité d’une action coordonnée au niveau fédéral, afin de permettre une harmonisation du droit visant la protection des animaux. En effet, les instruments juridiques mexicains concernant le bien-être animal sont pour la plupart adoptés au sein des États fédérés. Cette nouvelle répartition des compétences pourrait entraîner des conséquences politiques intéressantes, comme la diminution du pouvoir des lobbies tauromachiques qui s’appuient beaucoup sur les gouvernements régionaux.
Le décret annonçant cette réforme prévoit que « le Congrès de l’Union dispose d’un délai de cent quatre-vingts jours […] pour promulguer une loi généraliste sur le bien-être, les soins et la protection des animaux, en tenant compte de leur nature, de leurs caractéristiques et de leurs liens avec les humains, de l’interdiction de la maltraitance dans l’élevage, l’exploitation et l’abattage des animaux destinés à la consommation humaine, dans l’utilisation d’animaux sauvages dans des spectacles à but lucratif, ainsi que des mesures nécessaires pour gérer le contrôle des nuisibles et des risques sanitaires »1.
On peut relever l’incongruité d’un décret qui précise, en amont d’une loi, son contenu et qui fixe un délai pour son adoption, étant donné que le décret est inférieur à la loi dans la hiérarchie des normes juridiques, et se demander dès lors si cette loi sera bien adoptée et suffisamment ambitieuse.
Les défis à venir
Bien que ces réformes constitutionnelles apparaissent sur le papier comme une avancée majeure pour le bien-être animal, leur mise en œuvre effective se révèle être un défi considérable. Au-delà du droit, il y a la réalité politique et économique. La rédaction de la loi générale sur le bien-être animal sera inévitablement influencée par des intérêts industriels puissants : le pays, l’un des plus grands producteurs mondiaux de viande, de produits laitiers et d’œufs, doit faire face à la difficulté de concilier de nouvelles obligations juridiques avec les réalités économiques d’une industrie agricole profondément enracinée. Cette pression économique pourrait conduire à des compromis qui risquent d’atténuer l’impact des réformes, si bien que la volonté politique et la coordination entre les différents acteurs du secteur demeurent cruciales.
Pour que cette législation soit réellement efficace, il est indispensable d’instaurer un dialogue constructif entre les multiples parties prenantes. Dans le domaine de l’élevage par exemple, la transition ne se limite pas à une simple modification des textes de loi ; elle requiert également une transformation en profondeur des méthodes de production. Les agriculteurs devront être accompagnés dans cette transition pour intégrer des pratiques respectueuses du bien-être animal. Par ailleurs, il est essentiel que les infrastructures et les dispositifs de contrôle soient adaptés aux nouvelles exigences.
La coordination entre les diverses organisations de défense des animaux représente également un enjeu majeur. Ces associations, souvent spécialisées dans la protection d’espèces particulières ou engagées dans des causes spécifiques, doivent parvenir à un consensus afin de renforcer la portée des réformes. Qu’il s’agisse de la défense des animaux d’élevage, de la régulation des combats d’animaux ou de la protection des animaux de compagnie, la coopération et la communication entre ces entités sont essentielles pour éviter les divergences qui pourraient compromettre l’efficacité de la législation. En outre, le débat public et la participation citoyenne joueront un rôle déterminant dans l’élaboration de mesures réellement adaptées aux besoins et aux attentes de la société. L’implication de tous les acteurs, des agriculteurs aux défenseurs des animaux, permettra d’identifier les défis spécifiques et d’élaborer des solutions concrètes pour y répondre.
Au-delà de la rédaction et de l’adoption de la loi, son application concrète représente un défi opérationnel majeur. Il ne suffit pas d’annoncer des réformes ambitieuses : il faut également prévoir les moyens nécessaires pour les mettre en œuvre. Sans un financement idoine, une formation adaptée des forces de l’ordre et une sensibilisation continue du public, ces mesures risquent fort de rester lettre morte. La formation des agents chargés de veiller au respect des normes est indispensable pour assurer une application cohérente et efficace des nouvelles dispositions. De même, il est crucial d’informer et d’éduquer la population sur les enjeux du bien-être animal afin de susciter un soutien collectif en faveur de ces réformes. Cette dynamique, associée à un contrôle rigoureux, garantira que les intentions de la loi se traduisent par des actions concrètes sur le terrain.
Nicolas Bureau
- Décret portant réforme et ajout des articles 3, 4 et 73 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, en matière de protection et de soin des animaux, publié au journal officiel le 2 décembre 2024. ↩︎