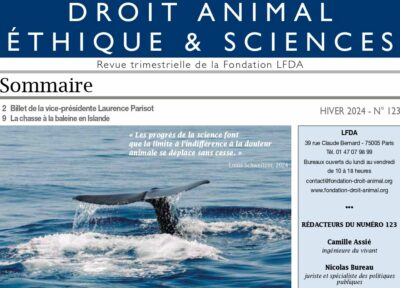Définition
Scepticisme envers la capacité de certaines entités (comme les animaux non-humains) à posséder une forme de conscience ou de sentience comparable à celle des humains. Synonymes : mentaphobie, amorphisme.
Le sentienscepticisme est souvent discuté dans des débats éthiques, philosophiques et scientifiques concernant le traitement des animaux, la recherche sur la conscience, et les droits des animaux. Ceux qui adhèrent à ce point de vue peuvent argumenter que les comportements observés chez les animaux non-humains peuvent être expliqués par des mécanismes instinctifs ou automatiques sans impliquer une véritable conscience.
Exemple d’utilisation
« Le sentienscepticisme remet en question l’idée que les animaux non-humains puissent ressentir la douleur ou éprouver des émotions de manière similaire aux humains. »
Rappel : la sentience vue par le Larousse
« Sentience (du lat. sentiens, ressentant) : pour un être vivant, capacité à ressentir les émotions, la douleur, le bien-être, etc. et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. »
Lire aussi : Le mot sentience entre dans le Larousse 2020
Origines et développement
Le terme sentienscepticisme est un néologisme que j’ai proposé pour faire résonance avec le climatoscepticisme, car il repose sur des mécanismes similaires de déni malgré l’accumulation de preuves scientifiques. Tout comme les climatosceptiques remettent en cause l’impact anthropique sur le climat malgré un consensus scientifique établi, les sentiensceptiques rejettent l’idée que les animaux puissent posséder une forme de conscience ou de sentience, en dépit des avancées en éthologie et en neurosciences.
Cette position s’appuie souvent sur des arguments philosophiques ou méthodologiques pour minimiser l’importance des données empiriques. Le concept vise ainsi à regrouper différentes formes de scepticisme envers la reconnaissance des états mentaux animaux, allant du mécanomorphisme cartésien à des postures plus nuancées mais tout aussi réticentes à admettre une continuité cognitive entre les humains et les autres espèces.
Débats philosophiques et positions extrêmes
L’idée que les animaux non-humains ne possèdent pas de conscience comparable à celle des humains remonte à des temps anciens. Les philosophes comme Descartes considéraient les animaux comme des machines, incapables de véritablement ressentir ou penser, une perspective connue sous le nom de mécanomorphisme. Cette vision a dominé la pensée scientifique et philosophique pendant des siècles, influençant la manière dont les humains traitaient les animaux et interprétaient leurs comportements.
Donald Griffin inventa ainsi le terme de mentaphobie (2013) pour désigner les fortes réticences à se référer à la conscience animale pour décrire le comportement des animaux, comme si on ne pouvait pas « comparer l’incomparable ». Cette réticence est aussi désignée comme l’anthropodéni ; son contraire, le fait de vouloir absolument attribuer des capacités humaines, est désigné anthropo-insistance.
L’anthropo-insistance se distingue de l’anthropomorphisme par son caractère systématique. Alors que l’anthropomorphisme consiste à attribuer ponctuellement des caractéristiques humaines aux animaux, l’anthropo-insistance est une posture qui impose systématiquement un cadre humain à l’analyse des comportements animaux, en considérant que les processus mentaux humains sont nécessairement présents chez d’autres espèces. Cette approche peut conduire à des biais interprétatifs, où l’on projette des intentions ou des émotions humaines sans preuve empirique. À l’inverse, le sentienscepticisme refuse de considérer ces attributs sans validation expérimentale, ce qui peut parfois aboutir à une négation excessive des capacités animales.
Le sentienscepticisme et l’anthropomorphisme représentent deux extrêmes dans notre approche de la compréhension animale. Alors que l’anthropomorphisme attribue des caractéristiques humaines aux animaux, souvent de manière exagérée, le sentienscepticisme tend à nier toute similitude significative. Les deux approches peuvent être sources de biais et de malentendus. Cependant, un équilibre critique entre ces deux perspectives peut enrichir notre compréhension des animaux.
Principe de parcimonie
Il y eut plusieurs allers-retours entre l’acceptation et le rejet d’un anthropomorphisme modéré pour expliquer le comportement animal. Ainsi, le canon de Morgan stipulait qu’il ne fallait pas complexifier un phénomène ou un comportement si ce n’était pas nécessaire. Edward Thorndike, le père du behaviourisme, disait que les anecdotes devaient être vérifiées par des expériences comportementales montrant généralement des mécanismes cognitifs simples chez les sujets animaux.
Le canon de Morgan, énoncé par le psychologue britannique C. Lloyd Morgan en 1894, est un principe fondamental en éthologie et en psychologie comparée. Il stipule qu’« en aucun cas une action animale ne doit être expliquée par un processus mental complexe s’il est possible de l’expliquer par un processus plus simple […] ».
Ce principe a été formulé pour éviter les excès de l’anthropomorphisme dans l’interprétation des comportements animaux et favoriser des explications basées sur des mécanismes cognitifs parcimonieux. Bien que ce canon ait joué un rôle majeur dans le développement des sciences du comportement, il a parfois été appliqué de manière restrictive, limitant ainsi la reconnaissance de certaines formes de cognition animale. Ces théories philosophiques et scientifiques d’animal-machine, ou mécanomorphisme, se sont pourtant vu mettre à mal par l’avènement de nombreuses études montrant que les animaux, en particulier les primates non-humains, possèdent également des émotions complexes, de l’empathie, des stratégies sociales, des capacités cognitives avancées et même un certain sens moral tel que l’honnêteté.
Éclairage des études modernes
Avec la science moderne, notamment en éthologie et en neurosciences, de nombreuses études ont commencé à démontrer que les animaux, et en particulier les primates, possèdent des émotions complexes, de l’empathie et même un sens moral rudimentaire. Ces découvertes ont remis en question le sentienscepticisme en montrant que des aspects importants de la conscience humaine peuvent être présents chez d’autres espèces. Des chercheurs comme Frans de Waal et Donald Griffin ont argumenté que considérer les animaux comme des êtres conscients est une hypothèse plus parcimonieuse et scientifiquement valable que de les voir comme des automates insensibles. Cependant, malgré ces avancées, le sentienscepticisme persiste chez certains scientifiques et philosophes qui doutent que la conscience animale soit comparable à celle des humains.
Risques et limites du sentienscepticisme
Le sentienscepticisme, bien qu’ayant des bases dans l’histoire de la philosophie et de la science, peut être un obstacle à notre compréhension complète du monde animal. Par exemple, sous-estimer les capacités cognitives et émotionnelles des animaux peut mener à des traitements éthiquement problématiques et à une gestion inadéquate de leur bien-être. L’un des exemples notables de l’impact du sentienscepticisme est la manière dont certains humains interprètent les comportements animaux à travers un prisme exclusivement humain. Cela peut conduire à des erreurs de jugement dangereuses, comme le montre l’exemple des pompiers américains tentant de sauver des chiens pris dans les glaces, où l’un des chiens mordit le pompier en raison d’une mauvaise compréhension de sa situation.
Conclusion
Le sentienscepticisme, tout en étant une position intellectuelle historiquement ancrée, doit être tempéré par les découvertes scientifiques modernes qui mettent en évidence les capacités cognitives et émotionnelles des animaux. Une approche équilibrée et critique, tenant compte à la fois des limites du sentienscepticisme et des risques de l’anthropomorphisme, est essentielle pour une compréhension éthique et scientifique du monde animal. En fin de compte, reconnaître et respecter la diversité des formes de conscience et de sentience dans le règne animal peut améliorer non seulement notre science mais aussi notre éthique envers les autres espèces.
Cédric Sueur
Références
Criscuolo, F., & Sueur, C. (2020). An evolutionary point of view of animal ethics. Frontiers in psychology, 11, 403.
de Waal, F. (2006). Primates and philosophers: How morality evolved. Princeton University Press.
De Waal, F. (2016). Are we smart enough to know how smart animals are?. WW Norton & Company.
Descartes, R. (1966). Discours de la méthode (1637), Introduction et notes par E. Gilson,Paris, 1.
Griffin, D. R. (2001). Animal minds: Beyond cognition to consciousness. University of Chicago Press.
Joulian, F. (2012). Comparer l’incomparable: des vertus et des limites de la comparaison hommes/primates. In Faire des sciences sociales. Comparer, O. Remaud, J.-F. Schaub et I. Thireau (dir.) 97-125.
Karlsson, F. (2012). Critical anthropomorphism and animal ethics. Journal of Agricultural and Environmental Ethics, 25, 707-720.
Mitchell, R. W., Thompson, N. S., & Miles, H. L. (Eds.). (1997). Anthropomorphism, anecdotes, and animals. Suny Press.
Pelé, M., Georges, J. Y., Matsuzawa, T., & Sueur, C. (2021). Perceptions of human-animal relationships and their impacts on animal ethics, law and research. Frontiers in Psychology, 11, 631238.
Spada, E. C. (1997). Amorphism, mechanomorphism, and anthropomorphism. In Robert W. Mitchell, Nicholas S. Thompson & H. Lyn Miles, Anthropomorphism, Anecdotes, and Animals. Suny Press.
Sueur, C. (2020). L’anthropomorphisme, entre le bien fondé et la dérive risquée. Ethics, 25(5), 707-720.
Sueur, C., Forin-Wiart, M. A., & Pelé, M. (2020). Are they really trying to save their buddy? the anthropomorphism of animal epimeletic behaviours. Animals, 10(12), 2323.
Sueur, C., Lombard, J., Capra, O., Beltzung, B., & Pelé, M. (2024). Exploration of the creative processes in animals, robots, and AI: who holds the authorship?. Humanities and Social Sciences Communications, 11(1), 1-12.
Sueur, C., Zanaz, S., & Pelé, M. (2023). Incorporating animal agency into research design could improve behavioral and neuroscience research. Journal of Comparative Psychology, 137(2), 129.
Thorndike, E. L. (1898). Animal intelligence: An experimental study of the associative processes in animals. The Psychological Review: Monograph Supplements, , 2(4), i–109.
Varsava, N. (2014). The problem of anthropomorphous animals: Toward a posthumanist ethics. Society & Animals, 22(5), 520-536.