Jean Gadrey, Aurore Lalucq, co-édition Les Petits Matins/Institut Veblen, 2015
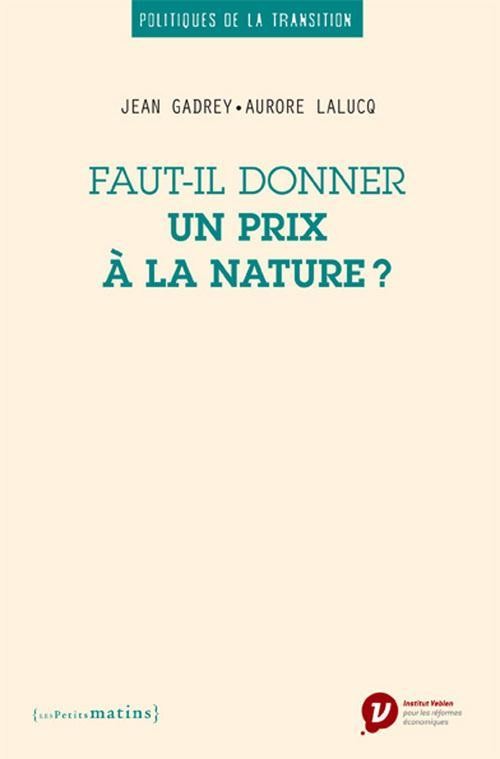
Il est de bon usage d’affirmer : « La santé humaine n’a pas de prix mais elle a un coût. » Cette déclaration qui est parfois transposée en ce qui concerne la nature a le mérite de suggérer les deux faces, l’une éthique, l’autre économique, d’un seul problème. Dans cet ouvrage de 122 pages, Jean Gadrey et Aurore Lalucq exposent de façon méthodique et claire comment est abordée la conciliation des activités humaines avec le respect de la nature. À notre époque où la tentation est grande de tout transformer en marchandise, en produit commercial, convient-il « d’accepter l’idée de la monétarisation de la nature afin d’infléchir certains comportements néfastes à l’environnement, ou à l’inverse, rejeter en bloc cette idée pour des raisons éthiques ? Cette question divise les défenseurs de l’environnement. Si certains estiment que « la nature n’a pas de prix » – tendant à négliger ou à condamner les tentatives de monétarisation –, d’autres nous disent que la protéger (ou ne pas la protéger) a un coût économique qu’il importe de mettre en évidence lorsque c’est possible. Ces deux affirmations sont justes. Loin de s’opposer, elles se complètent, et elles ont en partie motivé l’écriture de cet ouvrage. Avec ce livre nous avons cherché à rendre aussi accessibles que possible les enjeux et les termes d’un débat souvent jargonnant entre experts, parce qu’il nous semble important que les citoyens et les non-spécialistes s’en saisissent […] Nous espérons enfin contribuer à « décrisper » les controverses souvent passionnées entre certains écologistes et éclairer le lecteur sur l’utilisation de l’évaluation monétaire dans les cas où celle-ci s’avère légitime et suffisamment fiable. »
Dans la première partie de l’ouvrage, les auteurs précisent certains termes du débat tels que marchandisation, financiarisation et monétarisation et montrent comment est née l’idée de la monétarisation des enjeux écologiques.
Dans la deuxième partie, ils expliquent comment fonctionnent concrètement les diverses approches de la monétarisation telles que « la rémunération ou le paiement pour services environnementaux, les modalités dites de compensation (avec ou sans monétarisation), les marchés de droits ou de permis, et l’aide à la décision publique ou privée appuyée sur des évaluations monétaires ».
Dans la troisième partie sont présentées des études de cas concrets « plus approfondies sur la question de l’efficacité politique, et de la fiabilité des évaluations monétaires. »
La quatrième partie est consacrée à une réflexion sur l’intérêt et les limites des outils monétaires pour prendre soin de l’environnement ; « quand recourir à la monétarisation, quand ne pas le faire, à quelles conditions et pourquoi ? » Au vu des situations qui sont exposées dans le livre, il apparaît qu’il y a peu de cas où il existe une solution pleinement satisfaisante de protection de l’environnement.
Ce fait est sans doute lié à la complexité inhérente à chaque problème. Comment protéger un écosystème ou bien la biodiversité d’un site dès lors que l’on sait qu’ils reposent sur le maintien de multiples interactions animales, végétales, climatiques, géophysiques, qui sont souvent loin d’être identifiées pour un site donné.
La tentation est grande de « simplifier » le problème en ne retenant que tel ou tel composant du site pour en réaliser la monétarisation ou en assurer la compensation. « Il faut découper la nature en “ateliers fonctionnels” comme dans une unité industrielle – à l’opposé de la logique des écosystèmes –, chacun de ces ateliers produisant un service mesurable. Et il faut créer un marché de ces services. »
La monétarisation est-elle généralisable? Les auteurs évoquent à juste titre les valeurs immatérielles, esthétiques, aussi bien que la présence exceptionnelle d’une espèce animale ou végétale. Ils citent à ce propos le cas d’un conflit récent concernant l’implantation d’une scierie géante dans la forêt du Morvan dans lequel les opposants ont réussi « à la suite d’une décision du Conseil d’État prise sur la base de considérations relevant de la valeur intrinsèque de la nature et en particulier de certaines espèces protégées (en application d’une directive européenne de 1992) ».
Concernant la mise en place de la taxe carbone en Suède, les auteurs analysent les raisons particulières de sa réussite et constatent qu’elles ne seraient sans doute pas transposables comme telles dans d’autres nations. Les auteurs citent également la mise en place aux États-Unis d’un marché de permis d’émissions de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote, deux facteurs majeurs des pluies acides ; quinze ans plus tard le bilan est très satisfaisant pour les émissions de dioxyde de soufre alors qu’il est plutôt décevant pour celles d’oxydes d’azote.
Cette discordance s’explique, selon les auteurs, par le fait que l’ensemble des émetteurs de ces polluants était différent dans l’un et l’autre cas. Les auteurs ajoutent qu’en Europe « ce n’est pas la solution du marché qui a été préconisée pour lutter contre les pluies acides mais celle des normes européennes et nationales avec des résultats meilleurs que ceux obtenus aux États-Unis ». À propos du marché du carbone, les auteurs montrent comment sa mise en œuvre peut aboutir à des « monstruosités écologiques » où des multinationales cherchent à compenser leurs excès d’émissions au Nord, par la plantation de forêts dans les pays du Sud, afin de recevoir des crédits d’émission.
On remarquera que « les forêts sont ici réduites à une seule fonction, celle de puits de carbone à l’exclusion de toutes les autres qualités comme écosystèmes et comme lieu de vie pour les collectivités humaines. On encourage un productivisme forestier (plantation d’eucalyptus, de palmiers à huile, de pins transgéniques) destructeur des forêts et de la biodiversité au nom de la finance carbone ».
On peut noter au passage, en ce qui concerne la lutte contre l’accumulation des gaz à effet de serre, que les débats et les recherches de solutions se sont focalisés sur le dioxyde de carbone (exemple de fragmentation d’un problème?) comme si n’étaient pas en cause d’autres gaz comme le méthane, par exemple, qui est si souvent évoqué à propos de la digestion des ruminants ou de la fonte accélérée du permafrost. Au terme de cet ouvrage, dont la lecture est aisée et enrichissante, les auteurs présentent les cas où la monétarisation peut aider à protéger la nature.
Ils suggèrent quand utiliser les outils monétaires, sous quelles conditions et ce que les pouvoirs publics pourraient mettre en place. Selon eux, « les solutions réglementaires, les investissements de la transition écologique et les diverses fiscalités vertes apparaissent les plus efficaces pour protéger la nature. Néanmoins certaines valorisations monétaires et certains marchés suffisamment régulés peuvent constituer des solutions de second ordre ou complémentaires. »
Alain Collenot
Article publié dans le numéro 87 de la revue Droit Animal, Ethique et Sciences.



