Audrey Jougla, éditions Autrement, 2015
Profession : Animal de laboratoire d’Audrey Jougla se révèle être un bon livre délivrant beaucoup de vérité, que ce soit du côté des personnes travaillant dans l’expérimentation animale (chercheurs, animaliers, directeurs d’entreprise) comme des personnes la combattant (militants pour la protection animale). Audrey Jougla présente les problèmes récurrents dans chaque partie, et cela permet de mieux comprendre la situation conflictuelle actuelle. La question qu’Audrey Jougla aborde dans le livre est bien celle de la légitimité de l’expérimentation animale.
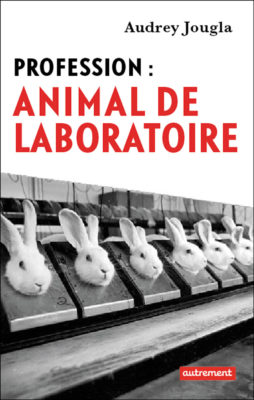
« 18 000 personnes décèdent des effets secondaires de médicaments testés sur les animaux » chaque année. Le principe d’économie l’emporterait selon l’auteure sur les principes éthiques. D’un côté les industries pharmaceutiques veulent mettre sur le marché de nouveaux médicaments et de l’autre côté, les chercheurs dans la recherche publique doivent publier des travaux pour trouver des financements. Pourtant, contrairement à ce qui est écrit dans le livre, la science aime le changement et se risque à trouver de nouvelles méthodes substitutives à l’expérimentation. Les chercheurs qui ont tenté de trouver de nouvelles méthodes se sont vu très bien récompensés. La communauté scientifique française aurait donc tout intérêt à trouver des méthodes alternatives pour être innovante et compétitive dans la Recherche.
L’expérimentation animale en quelques chiffres
Les nouveaux chiffres concernant l’expérimentation animale viennent de paraître et montrent une baisse de 20 % du nombre d’animaux utilisés en France entre 2010 et 2014. Mais la raison de cette baisse reste inconnue ; serait-ce une amélioration des méthodes alternatives, un renforcement des réglementations et de leur mise en œuvre via les comités d’éthique ? Les comités d’éthique ont actuellement à valider tout projet de protocole de recherche impliquant l’utilisation d’animaux et ils rejettent très souvent les saisines pour modification puis resoumission (contrairement à ce qui est écrit dans le livre Profession : Animal de laboratoire). Parmi les 1 769 618 animaux utilisés en expérimentation animale en France, selon les statistiques de 2014, 51 % le sont dans le cadre de procédures imposées par la législation ou la réglementation, c’est-à-dire dans des tests de toxicité de produits souvent déjà mis sur le marché (produits pharmaceutiques mais également produits d’hygiène ou alimentaires). Audrey Jougla soulève bien cette obligation déroutante, qui demande encore de tester ces produits sur animaux : « La contrainte réglementaire coûte cher aux animaux. » L’utilisation de certains tests alternatifs déjà existants permettrait de diminuer de 70 % le nombre d’animaux utilisés en toxicologie. Audrey Jougla cite aussi dans son livre beaucoup d’expérimentations à « conditionnement négatif » en recherche fondamentale ou appliquée (piscine de Morris ou contention forcée), dont le résultat escompté pourrait finalement être obtenu par du conditionnement positif (labyrinthe ou écran tactile ou reconnaissance du suivi du regard avec récompense alimentaire). Ces derniers tests permettraient de s’affranchir du stress variable selon les individus testés, ce qui peut invalider les tests. Régler les deux problèmes que sont les tests de toxicité et les expériences de conditionnement négatif permettrait de faire avancer la condition animale d’un grand pas dans la recherche en diminuant le nombre d’animaux utilisés et en améliorant les méthodes, soit deux des 3R (remplacer, réduire, raffiner) de Russell et Burch.
Méthode des 3 R: Remplacer, réduire, raffiner
Expérimenter sur un animal se définit via ces 3R. Il ne faut pas les confondre et il faut respecter chaque point à chaque fois qu’un animal est utilisé dans un protocole :
- Remplacer : tout d’abord, est-il possible de remplacer l’utilisation de cet animal par des méthodes alternatives ?
- Réduire : le nombre d’animaux utilisés est-il réduit à son minimum ?
- Raffiner :
- le bienêtre de l’animal est-il respecté durant sa vie captive ?
- la souffrance qu’on peut lui infliger dans le cadre du protocole expérimental est-elle inévitable et son évolution bien suivie ?
- la mise à mort de l’animal est-elle correctement effectuée.
Ce n’est pas parce qu’un protocole expérimental induit une souffrance chez l’animal que le chercheur ou le technicien ne doit pas lui garantir de bonnes conditions de captivité et une mise à mort instantanée, indolore et non génératrice d’angoisse ; et ce n’est pas parce qu’un animal va être mis à mort que le chercheur ne doit pas veiller à son bien-être. Chacun de ces points doit être bien pris en compte. D’un point de vue éthique mais également réglementaire, nous ne devrions plus voir de macaques (les singes les plus utilisés en recherche) dans des cages individuelles d’un mètre cube. Les méthodes que nous utilisons aujourd’hui sont suffisamment avancées pour que des singes en protocole expérimental puissent évoluer à plusieurs dans une grande cage. Et pourtant, comme Audrey Jougla l’écrit dans son livre et contrairement à ce que disent certains chercheurs, il y a bien encore aujourd’hui des macaques en protocole expérimental dans des cages d’un mètre cube. Pourquoi ? Le temps ou l’argent sont de mauvaises excuses. Contrairement à ce qu’écrit Audrey Jougla, un animal peut s’adapter à la captivité (que l’on soit pour ou contre cette captivité est une autre question) et il n’a pas forcement conscience de sa condition, mais les modalités de cette captivité doivent être adéquates au bien-être physique et mental du sujet en question. Un ours par exemple pourra s’habituer à un parc boisé d’un hectare mais ne pourra pas vivre dans une cage ou une fosse cimentée.
4e R?
Un point similaire aux 3R est soulevé également par Audrey Jougla : c’est celui de la retraite des animaux ou de leur replacement/réhabilitation que certains nomment le 4e R. Ici se pose la vraie question que certains chercheurs ne sont pas encore prêts à envisager, le fait que les animaux ne soient pas euthanasiés en fin de protocole expérimental mais bien replacés. De telles retraites ou replacements des animaux, de laboratoire, de divertissement existent mais le principe a du mal à se généraliser, car cette retraite pour animaux soulève la question du financement (qui finance ? comment augmenter ces replacements sans fonds supplémentaires ?). Une telle retraite pose aussi la question d’un droit des animaux : ce terme de retraite implique un travail pour les animaux (1) et si nous attribuons une retraite aux animaux parce qu’ils ont travaillé, cela pourrait soulever d’autres questions plus générales de droits des animaux).
« Souffrance » des animaux
Un autre point important du livre porte sur la « souffrance » des animaux (2). Il faut avant tout définir ce qu’est la souffrance : la souffrance est la capacité d’être conscient d’une douleur c’est-à-dire de l’existence d’une intégration de la nociception au niveau du système nerveux central. La souffrance comprend donc un aspect cognitif et émotionnel.
Par exemple, une moule ou une méduse, qui n’ont pas de système nerveux central, sont incapables de ressentir de la douleur ou de la souffrance car il n’y a pas d’intégration de la nociception. En revanche, on considère que tout oiseau ou mammifère ressent la douleur et la souffrance et de nombreuses recherches sont faites sur les autres taxons (reptiles, poissons, crustacés, etc.).
Quid de la douleur chez le lézard qui perd sa queue pour se protéger du prédateur ou du serpent qui s’échappe face à une piqûre mais qui peut rester sous une lampe chauffante quitte à être brûlé au 3e degré ?
Le terme souffrance est peut-être trop utilisé par les militants de la protection animale : selon l’espèce et le protocole, un animal utilisé en expérimentation animale ne souffre pas forcément. Ce n’est pas parce qu’un animal est maintenu en captivité et utilisé en recherche qu’il souffre automatiquement. Il peut « bien vivre » si ses besoins sont respectés. Certains singes ont appris à venir pour que leur soit fait un prélèvement de sang, d’autres vivent en semi-liberté et peuvent participer quand ils le souhaitent et par eux-mêmes à des expériences comportementales. « Moins les animaux sont contraints et plus on a des résultats expérimentaux qui vont être valables. » Mais il faut faire attention aux quatre points cités précédemment : ce n’est pas parce qu’un animal ne souffre pas qu’on peut l’utiliser sans respecter le fait qu’il reste un être vivant et possède une valeur intrinsèque, comme l’énonce clairement la directive expérimentation de 2010.
Hiérarchisation des espèces
Audrey Jougla aborde aussi la hiérarchisation des espèces dans leur utilisation. Est-il pire d’expérimenter sur un humain, sur un primate non humain ou sur une souris ? Quoique cette question légitime l’expérimentation sur les animaux en laboratoire, elle n’en reste pas moins primordiale. Cependant, il ne faut pas aborder la hiérarchie en termes de similitude génétique avec l’homme, mais bien en termes de capacités cognitives (conscience, raison, empathie), sociales et émotionnelles (douleur, stress, souffrance) que chaque espèce possède et compte tenu des besoins qui en sont la conséquence. Audrey Jougla soulève bien ces points dans son livre. L’idée du devenir de l’individu est également importante. Des questions posées dans le livre nous mettent face à ce dilemme : « Est-ce que Jean [un enfant de cinq ans] vaut plus qu’un petit chat ? » « Un chien et un nourrisson sont sur un bateau menacé de périr, lequel des deux sauvez-vous ? » Dans presque toujours 100 % des situations, l’humain est sauvé face à l’animal. Mais vient ensuite la question « Combien il faut de chats pour être égal au petit garçon ? » « Et si l’enfant est trisomique ? » : toutes questions qui ont mené Singer ou Francione à éviter la hiérarchisation des espèces.
On teste les nouvelles molécules dans un ordre précis
Cette hiérarchisation des espèces conduit à mener la recherche expérimentale à tester les nouvelles molécules dans un ordre précis. Ainsi une molécule médicamenteuse qui fonctionne sur des souris, aura été préalablement testée sur des cellules et des tissus organiques, même via la bio-informatique. Cette molécule sera ultérieurement testée chez le chien puis sur le singe avant d’être testée sur les humains. L’ensemble de ces filtres conduit à ce que très peu de molécules soient testées sur les humains afin d’éviter tout effet secondaire dommageable. Parfois, cependant, et comme Audrey Jougla l’écrit, une molécule qui conduit à des effets secondaires sur les souris ou les chiens pourrait très bien fonctionner sur l’homme, ce n’est donc pas nécessairement prédictif. De la même manière, une molécule qui fonctionnera chez les souris et les chiens peut conduire à des effets secondaires chez les humains. La molécule n’est cependant pas forcément perdue car d’autres recherches et modifications protocolaires peuvent être effectuées afin d’améliorer son efficacité et stopper les effets secondaires. Bien sûr, ceci sous-entend d’autres expériences sur les animaux… L’ensemble de cette procédure expérimentale – souris puis chien puis primate – rend aussi inutile toute manipulation des résultats par sélection spécifique de souches d’animaux, si ce n’est pour publier un article scientifique supplémentaire. Ce qu’il faut comprendre, c’est qu’il y a probablement plus de molécules qui ne se retrouvent pas sur le marché, du fait de cette multiple barrière expérimentale, que de molécules qui s’y retrouvent et provoquent des effets dommageables sur l’homme.
À ce propos, Audrey Jougla relate le fait que beaucoup de médicaments testés sur les animaux échouent sur l’homme. Cela est un fait et ce taux est élevé (environ 85-90 %), il ne faut pas se le cacher. Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Surtout pas que l’expérimentation animale est inutile mais probablement qu’elle peut être améliorée au profit des animaux utilisés. D’abord, il est difficile de remettre en question des recherches portant sur des maladies graves. Mais est-il nécessaire de « sacrifier » des milliers de souris afin de soigner la calvitie, quelles que soient les origines de cette dernière. Il faut absolument se poser ici la question de l’utilité d’un projet de recherche :
toute recherche est intéressante, mais toute recherche mérite-t-elle l’utilisation d’animaux ?
Ici s’oppose l’éthique animale face à l’avancée de la science et de la connaissance. Les comités d’éthique vérifient bien si des méthodes alternatives pourraient remplacer le protocole proposé et si le nombre d’animaux présentés est adéquat, mais pas si la question derrière le projet vaut le sacrifice de ces animaux. Audrey Jougla rapporte dans son livre qu’un laboratoire aux États-Unis travaillait sur la privation maternelle totale à la naissance : des singes nouveau-nés étaient séparés dès leur naissance de leur mère et pouvaient avoir comme substituts une peluche ou un objet piquant afin de comprendre l’attachement maternel. Ces recherches ont finalement été interdites en décembre 2015 soit disant pour des raisons financières mais le fond du problème était bien la valeur de la question posée par rapport aux souffrances infligées à ces jeunes singes.
Le problème de la nature humaine
Enfin le dernier point que l’auteure a bien identifié est celui de la nature humaine. L’humain a la fâcheuse manie de toujours vouloir avoir raison. Il serait déraisonnable qu’une personne puisse dire à elle seule qu’elle est pour ou contre l’utilisation des animaux dans la recherche face à ce problème aussi complexe. Nous pouvons soulever des points positifs ou négatifs, certes, mais nous ne pouvons sûrement pas affirmer en tant que personne que nous sommes pour ou contre. Notre opinion est en effet facilement influencée par notre vécu et par la manière dont les questions sont posées. Ainsi, si on demande aux Français s’ils sont « pour » l’expérimentation animale, ils diront « non » à 60 %. Mais si on leur demande s’ils seraient prêts à accepter que des animaux soient utilisés pour soigner une maladie infantile, ils diront « oui » à 60 %. C’est à la société dans son entièreté ou à un comité d’experts représentatifs (utilisateurs d’animaux et militants de la protection animale réunis) de discuter de la pertinence de l’expérimentation animale dans la recherche. Si nous pouvions avoir un peu plus de recul et être plus tolérants, nous pourrions, utilisateurs d’animaux et militants de la protection animale, mieux discuter, nous comprendre et peut-être arriver à certaines solutions. Audrey Jougla cite comme exemple le Graal qui est une association prônant la réhabilitation des animaux de laboratoire. Cette association, par son action de défense des animaux mais collaborant directement avec certains laboratoires se voit à la fois mal vue par certains utilisateurs d’animaux de laboratoire mais également par certains militants de la protection animale. De même, les membres scientifiques de la LFDA se sont fait traiter de vivisecteurs dès 1977 parce qu’ils refusaient d’avoir l’opinion tranchée des antivivisectionnistes. Ne pouvons-nous pas accepter et comprendre les actions bénéfiques de chacun, en tant que personne ou association, même si nous n’avons pas les mêmes convictions ?
La question de l’utilisation des animaux dans la recherche est une question sociétale actuelle majeure. Certains peuvent être pour l’expérimentation animale, d’autres peuvent être contre, mais ce qui est sûr, c’est que nous pouvons déjà tous avancer sur les points qui ont été soulevés dans ce compte-rendu et bien décrits dans le livre d’Audrey Jougla, et ce quelle que soit notre opinion sur l’utilisation des animaux dans la recherche.
- « Le travail des animaux d’élevage, un partenariat invisible ? » Porcher J., 2015. Article publié dans le Courrier de l’environnement de l’INRA n° 65, mars 2015.
- Souffrance animale – De la science au droit. 2013. Éditions Yvon Blais ISBN : 978-2-89635920-2.
Article publié dans le numéro 91 de la revue Droit Animal, Éthique & Sciences.



