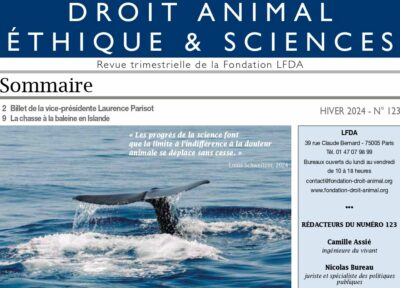La loi maltraitance du 11 novembre 2021 a introduit l’interdiction d’exploiter des animaux sauvages captifs dans les spectacles itinérants, en discothèque et lors d’émissions de variétés, une mesure entrée en vigueur il y a un peu plus d’un an. Toutefois, cette interdiction ne s’étend pas aux animaux sauvages et domestiques utilisés pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Quand ils sont précisément exploités à ces fins, leur protection demeure un vide juridique. Dès lors, certaines initiatives cherchent à encadrer leurs conditions de vie pendant les tournages. Quelles sont les véritables limites de ces dispositifs, et dans quelle mesure sont-ils effectivement appliqués ? Penchons-nous de l’autre côté des écrans.

Le droit à l’image des animaux domestiques
Dans la loi française, la photographie est considérée comme une œuvre dont la propriété revient à celui qui l’a produite. Pour pouvoir utiliser l’image d’une personne, l’auteur de la photographie ou de la vidéo doit obtenir une autorisation écrite préalable. En revanche et sans surprise, les animaux ayant dans la loi un statut de « biens » ne bénéficient pas directement de la protection judiciaire du droit à l’image. En outre, il n’est pas non plus possible de revendiquer ce droit pour les animaux dont on est soi-même propriétaire. En effet, l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 mai 2004 a restreint le droit exclusif de l’image d’une chose du propriétaire, stipulant que celui-ci ne peut contester la diffusion du droit à l’image qu’en cas de trouble anormal.
Ainsi, il est parfaitement légal de prendre des photos de nos compagnons ou d’autres animaux domestiques, à tout moment et sous toutes les postures, sans avoir à demander une quelconque autorisation. De nouveau, l’intimité et la dignité des animaux ne sont malheureusement pas protégées par la législation actuelle.
Le cas particulier des animaux sauvages mis en avant par les influenceurs sur les réseaux
Depuis 2023, grâce à l’action de l’association AVES France via l’aide de CAP, les animaux sauvages captifs bénéficient d’une protection ciblée, spécifiquement en ce qui concerne leur utilisation par les influenceurs commerciaux sur internet. Une disposition de la loi visant à lutter contre les dérives de certains influenceursleur interdit d’effectuer des promotions impliquant des espèces dont la détention n’est pas autorisée en France. Ainsi, il est désormais impossible de voir des publications mettant en avant des animaux comme le caracal, le serval ou une tortue protégée pour la vente de biens, de services ou pour promouvoir une cause quelconque – cause animale comprise.
Bien que cette législation soit encore limitée, elle contribue à protéger les animaux sauvages, qui ne sont pas faits pour vivre en contact étroit avec les humains. Elle aide donc dans une certaine mesure à réduire les effets de mode visant à détenir des animaux sauvages chez soi, limitant ainsi la demande autour de ces espèces, dans un contexte où le trafic d’animaux protégés demeure l’un des plus lucratifs au monde.
La question de la dignité animale dans les spots publicitaires
Connaissez-vous l’ARPP ? Il s’agit de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité, « un organisme de régulation visant à promouvoir une publicité saine, véridique et loyale ainsi qu’une communication responsable ». Cet organisme comprend un conseil de l’éthique publicitaire, constitué à parts égales d’experts indépendants et de professionnels. Dans un avis de décembre 2010, celui-ci a formulé des recommandations sur la représentation des animaux dans les publicités, qui le sont dans l’objectif de passer des messages ou des symboles.
En ce qui concerne la représentation de maltraitances ou de souffrance animale, l’ARPP établit une « ligne rouge à ne pas franchir », considérée comme une « borne assez claire de l’inacceptable ». Cette position repose sur l’idée que de tels mauvais traitements doivent être rejetés, « dans le sens où l’animal y est représenté comme un objet ». Pourtant, si l’animal n’est pas un objet, l’ARPP considère en même temps que « l’animal n’est pas une personne ». Elle établit une distinction nette entre l’homme et l’animal, en estimant qu’il existe « une vraie différence qui pourrait se situer au niveau de la pensée conceptuelle ». Par ailleurs, l’ARPP distingue les vertébrés des invertébrés, ces derniers étant supposés dépourvus d’émotions ou de conscience. Toutefois, cette affirmation peut être nuancée par la Déclaration de New York sur la conscience animale publiée en 2024, qui reconnaît à l’issue d’un consensus scientifique que les céphalopodes et certains insectes possèdent des capacités cognitives avancées.
Lire aussi : « La déclaration de New York sur la conscience animale met l’accent sur notre responsabilité » (revue n° 122)
La publicité recourt fréquemment à des représentations animales pour susciter l’humour, l’attendrissement, mais parfois aussi, plus rarement, pour contourner des interdits sociaux ou réglementaires, notamment en ce qui concerne la représentation de scènes à caractère sexuel. À plusieurs reprises, des citoyens ont signalé à l’ARPP des situations où des animaux étaient dépeints de manière humiliante, risible ou niant leur animalité. Bien que l’ARPP reconnaisse que la dignité animale est une « idée […] qui existe », elle considère cette notion comme une « projection anthropomorphiste », qu’elle choisit de ne pas prendre en compte. Son conseil éthique n’y voit aucun inconvénient, y compris lorsqu’il s’agit de représenter des animaux adoptant des comportements humains.
Toutefois, l’ARPP impose une limite en excluant l’utilisation d’animaux pour contourner des règles déontologiques « qui s’imposeraient si les personnages étaient humains ». Il ne s’agit pas ici de respecter la dignité animale, mais de contrôler les comportements d’animaux humanisés pour préserver la dignité humaine. En revanche, qu’on ne s’y trompe pas, « la représentation de l’homme réduit au rang de bêtes » est, elle, strictement « bannie ». Cette position, maintenue dans le rapport de 2021 du Conseil éthique publicitaire, reste bien éloignée des attentes des associations de protection animale.
Du côté des productions cinématographiques, des labels partiellement respectés
Dans le cinéma, les animaux sont considérés comme de simples accessoires de scène. La convention collective nationale de la production cinématographique de 2012 définit en effet parmi les missions du régisseur d’extérieurs cinéma « la recherche, de la fourniture et de la restitution aux fournisseurs, s’il y a lieu, de tous les accessoires, animaux, […] liés à la réalisation du décor et des accessoires jouant ». Un avenant de 2013 précise d’ailleurs qu’une indemnité de 25 € est allouée aux acteurs de complément qui utilisent ces accessoires à l’image, les animaux étant inclus dans cette catégorie.
Certains professionnels du secteur se sont unis pour dénoncer le manque de considération accordée aux animaux sur les plateaux de tournage. Cinquante-six d’entre eux, dont des membres de l’association centrale dans le secteur Assistants Réalisateurs & Associés (ARA), ont participé à une enquête menée entre octobre 2023 et février 2024. Cette enquête révèle que 88 % des répondants réclament la présence d’un référent en bien-être animal indépendant, et pour 80 % d’entre eux, il s’agirait d’un vétérinaire. Actuellement, la présence d’un vétérinaire n’est soumise à absolument aucune obligation réglementaire. Les professionnels interrogés ont également dénoncé que, selon leurs connaissances, un tiers des films impliquant des animaux les ont exploités sous la contrainte. Les travaux de Corinne Lesaine, experte en la matière, sont activement diffusés au sein de l’ARA pour encourager l’engagement et la réflexion parmi les professionnels du cinéma volontairement impliqués dans la cause animale.
En France, les associations se mobilisent depuis de nombreuses années pour instaurer et faire respecter des labels garantissant des conditions de vie décentes pour les animaux sur les plateaux de cinéma. En 1980, la LFDA, alors connue sous le nom de “Ligue”, avait d’ailleurs développé un label spécifique à cet effet. Aujourd’hui et en France, le label de référence dans ce domaine est le Visa de la Fondation 30 Millions d’Amis. La Fondation délivre son visa après un contrôle rigoureux et approfondi réalisé par un ou plusieurs vétérinaires mandatés et rémunérés par ses soins. Au moindre doute concernant l’un des 36 points constitutifs de la charte, le visa n’est pas attribué, sans possibilité d’appel. Malgré ces démarches, les organismes de protection animale ne disposent toutefois d’aucun pouvoir contraignant pour forcer les producteurs à garantir des conditions de travail acceptables pour les animaux employés dans leurs productions. Ils ne peuvent s’en remettre qu’aux signalements de maltraitance classiques auprès des forces de l’ordre, qui sont pour l’instant rarement suivis de peines.
Lire aussi : « Utiliser l’image des animaux, une autre forme d’exploitation » (revue n° 120)
À l’international, il est courant de voir sur les génériques de films américains le label No animals were harmed (aucun animal n’a été blessé) délivré par l’organisation American Humane. Ce label impose des directives spécifiques selon les espèces animales, en plus de recommandations générales. Des équipes composées de vétérinaires et de spécialistes du comportement animal supervisent ainsi les tournages de films et de séries, tant aux États-Unis qu’à l’échelle mondiale. Cependant, en 2015, l’association PETA a publiquement dénoncé certains films ayant obtenu ce label, accusés de maltraitance et de la mort accidentelle d’animaux.
Des employés d’American Humane ont par ailleurs témoigné anonymement, affirmant que l’organisation avait intentionnellement dissimulé de nombreux accidents survenus sur les plateaux, les qualifiant d’ « erreurs » plutôt que de négligences, afin d’éviter toute responsabilité. Ajoutons à cela que l’organisation a été financée en grande partie par de grands groupes de cinéma, ce qui soulève des questions sur son indépendance.
Conclusion
De nos jours, nous voyons plus souvent les animaux derrière les écrans que dans leur habitat naturel. Leur image est exploitée pour quelques secondes ou minutes de divertissement, tandis que, pour eux, cela représente des heures de travail et de captivité, en contact étroit et forcé avec des humains. Bien que de timides avancées aient été réalisées, des lacunes demeurent. Les législations actuelles, comme celles encadrant l’utilisation des animaux sauvages ou les normes dans la publicité, témoignent d’une prise en compte insuffisante de la sensibilité animale. De plus, les dispositifs de contrôle sur les tournages manquent de pouvoirs contraignants et sont souvent insuffisamment appliqués. En dépit des efforts d’associations et de professionnels engagés, la situation reste largement tributaire de l’autorégulation, laissant encore trop de place à l’exploitation des animaux comme simples objets de divertissement.
Ainsi, la question du respect des droits des animaux sur les plateaux de cinéma et dans la publicité demeure une problématique urgente en quête de réelles solutions, nécessitant une mobilisation plus forte pour garantir leur bien-être et leur protection.
Camille Assié