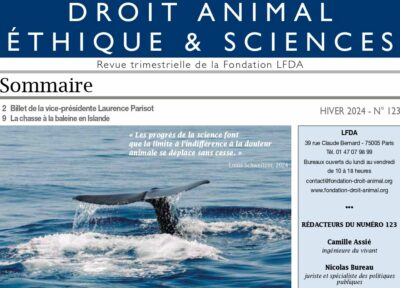Compte rendu de lecture
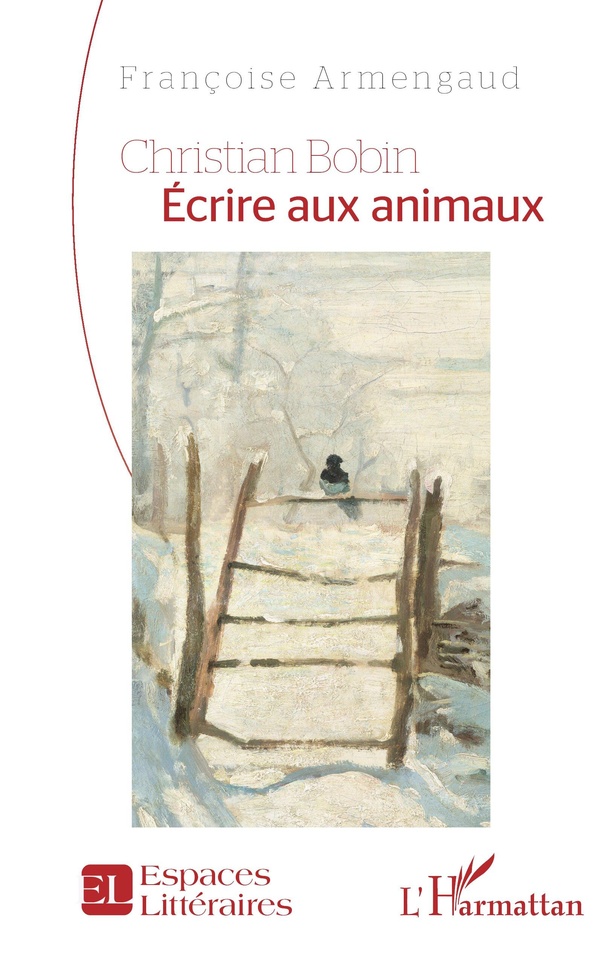
À côté de sa carrière d’enseignante, à Rennes puis à Paris-Ouest-Nanterre, la philosophe Françoise Armengaud a mené un double parcours d’exégète de la littérature et des poètes et aussi d’animaliste, militante pour le respect des animaux. Certains de ses livres ont déjà traduit ce double parcours comme Requiem pour les bêtes meurtries-essai sur la poésie animalière engagée (Kimé, Paris, 2015, voir Droit animal, Éthique & Sciences, 2016, n° 88). Le présent ouvrage vise à analyser, à propos des animaux, l’écriture de l’écrivain et poète Christian Bobin, récemment disparu.
« Ce qui […] m’a fortement intéressée chez Christian Bobin, confie Armengaud, ce sont les animaux tels qu’ils apparaissent dans ses livres […] et c’est tout aussi bien la relation poétique et spirituelle qu’il entretient avec eux, j’oserai dire qu’il invente pour eux » (p. 12). On sait, à ce propos, l’excellence du style des proses poétiques de Bobin, ciselées « avec une minutie d’orfèvre » (p. 37), propres à faire vivre « ce moment capital où s’instaure entre deux êtres l’aventure d’une relation […] brève et éphémère […] l’instant fugitif d’un aperçu » (p. 13). À cet égard, les écrits de Bobin peuvent sans doute être rapprochées de la quête du vécu de l’instant, chère au haïku japonais, cette expérience existentielle intense et irremplaçable, qui mène à la spiritualité.
Reprenant ici le terme créé par Élisabeth de Fontenay, celui de « Zoolège », « une manière moins datée historiquement de désigner ce [qu’on] appelle un Bestiaire » (pp. 14-15), Armengaud nous entraîne à la rencontre du zoolège de Bobin, ce monde des « bêtes », un terme qui « comporte à la fois une jonction et une coupure avec les humains » (p. 17). Le zoolège évoque d’abord un monde des animaux-anges (p. 25), capables, comme chats dans leur mystère, de rapprocher les hommes de Dieu, ou comme les chevaux, seuls capables d’apprendre aux enfants à se connaitre profondément eux-mêmes. Sous cet angle il ne faut pas hésiter « à envisager avec Christian Bobin les animaux comme des théologiens » (p. 35), chez qui on retrouve parfois une « félicité céleste » (p. 36) que n’aurait pas reniée François d’Assise. Et une abbatiale n’est-elle pas comparable à une ruche d’abeilles où, selon la formule de Bobin, « la grâce est le fruit de milliers d’effacements » (p. 42) ?
Dans un de ses livres le plus clairement chrétien, Le Christ aux coquelicots, Bobin imagine une vie du Christ peuplée du « sommeil des renards [et du] silence des penseurs » (p. 51). Nous voici, avec l’animalité, proche de la contemplation mystique. Et plus loin, le Christ lui-même devient tigre, mais « un tigre de douceur » (p. 53). Dans d’autres ouvrages, le Christ se rencontre dans un chevreuil tué par un train, dans une petite corneille martyrisée par des gamins ou même dans la roue colorée du paon, qui permet « d’aller du visuel vers le mystique » (p. 59).
Pas étonnant alors à ce que les animaux puissent devenir nos modèles : une souris « avec la souplesse d’une ballerine » (p. 62), les chats qui vont « de la majesté millénaire à la plus placide familiarité » (p. 63). « Les papillons […] les abeilles […] mes maîtres sont devant moi, qui m’instruisent sans y penser », confie Bobin (p. 65). Modèles aussi puisque l’observation des comportements animaux est pulsion pour l’écrivain à écrire : les « temps de vie et d’écriture [ont] des rythmes et allures semblables » (pp. 72-73). « La substance de l’écriture […] se rencontre dans les fleurs, les arbres, les animaux » (p. 75). Les animaux sont aussi « maîtres de musique » (p. 79), chats attentifs aux rythmes, mais aussi merles, moineaux, mésanges, moucherons… Se plongeant dans l’animalité, Bobin devient lui-même, à l’occasion, bélier, lézard, oiseau ou ours.
Ces maîtres animaux conduisent Bobin à une dialectique entre « un dynamisme de l’arrachement, le bond, la danse et, par ailleurs, un goût de la quiétude, du repos » (p. 67), une dialectique où l’arrachement mime l’envol du papillon ou « un jeune tigre qui bondit » (p. 68) alors que la quiétude renvoie à « l’imperturbable calme » (p. 66) de la salamandre. Le propos du poète évoque donc le chemin éternel de la nature entre élan vital et nécessaire repos, entre « la vivifiante sauvagerie des loups [et] la pure innocence des vaches » (p. 125). En même temps, la beauté animale conduit aisément à l’extase esthétique, « l’émerveillement à l’état pur » (p. 91). Les oiseaux « sont les prêtres de la forêt », « des prophètes que les dictionnaires de mystique négligent », constate Bobin (p. 104) et « la rencontre du visage animal nous procure un lien immédiat à l’éternel » (p. 95). Un échange de regard avec un cerf peut nous faire rejoindre des moments « délivrés du temps » (p. 100). Quant aux chats, rappelle Armengaud, ils « ont contact immédiat avec le divin » (p. 117).
Si l’écriture poétique peut être un chemin vers la spiritualité, l’œuvre de Bobin sur les animaux en est un des meilleurs témoignages. Merci à Françoise Armengaud d’avoir su si opportunément nous le rappeler.
Georges Chapouthier