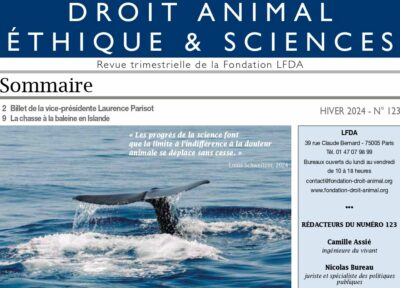Compte rendu de lecture
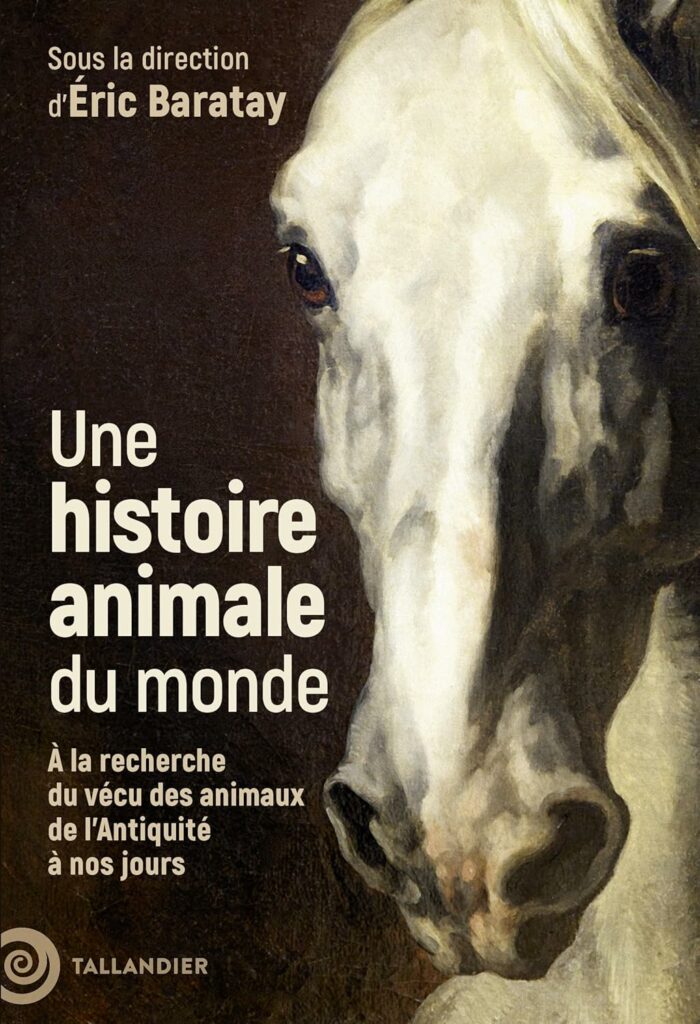
Depuis plusieurs années, l’historien Éric Baratay plaide pour une relation de l’histoire qui puisse rendre à certains de ses acteurs, en l’occurrence les animaux, leur place méritée. En d’autres termes, il s’agit d’une révolution dans la conception même de l’histoire, certes écrite par des sujets humains, mais qui vise à remettre au centre du discours le vécu existentiel de ses acteurs animaux. Le présent livre constitue une somme de cette nouvelle conception.
On y trouvera, bien entendu, la justification de ce projet dans des articles écrits par Éric Baratay lui-même. « Les animaux ont largement participé à l’histoire humaine […] mais on ne comprend pas bien leur rôle et leur importance si on ne se place pas de leur côté » (préface, p. 7). Ces considérations s’inscrivent dans les récentes découvertes de la neurobiologie et de l’éthologie, qui montrent « que nombre d’espèces sont intelligentes … à leur manière et qu’il n’y a pas une seule intelligence, sous-entendu l’humaine, mais des intelligences plurielles » (postface, p. 326). À cet ouvrage exemplaire ont contribué une dizaine de spécialistes, principalement historiens. Le panorama est très large : de l’Antiquité à nos jours.
On y rencontre les éléphants de l’Antiquité, des animaux sociaux et particulièrement intelligents, mais des animaux paisibles, parfois entraînés dans la guerre, et cependant très émotifs : « il semble que […] la blessure d’un individu tombé à genoux sous les coups puis la mort soudaine d’un autre membre du troupeau […] provoquent une réaction de désespoir chez le pachyderme » (Marco Vespa, p. 291). L’étude des « cailles, poules et paons à la conquête de la Méditerranée antique » (p. 91), par Christophe Chandezon, montre comment la circulation de ces volatiles a façonné l’évolution des civilisations humaines, « combien une histoire de la mondialisation ne peut s’écrire sans penser aux animaux » (p. 109).
Lire aussi : Lecture : Animal & droit. Bestiaire, patrimoine juridique, défis contemporains
Au Moyen Âge, Fabrice Guizard révèle que les chiens, devenus de nos jours les meilleurs amis de l’homme, n’ont pas toujours bénéficié de ce statut privilégié : « entre les cabots faméliques des rues des villages et des villes […], les chiens de meute cynégétique (sélectionnés et dressés pour la chasse […], le peuple canin est constitué d’une grande majorité de chiens ruraux polyvalents » (p. 137). Emmanuel Porte remarque d’ailleurs que cette situation médiévale européenne se retrouve encore de nos jours dans d’autres pays, puisque : « les chiens de villages africains, les meutes de chiens moscovites, les errances plurielles des villes d’Amérique centrale et latine, sont autant d’exemples actuels » (p. 171), qui rappellent le statut des chiens européens au Moyen Âge. Au XVIIIe siècle, la mode des oiseaux de compagnie, contée par Clotilde Boitard, montre comment la fascination des hommes conduit à l’enfermement en cages des oiseaux, privés de la diversité de leur milieu naturel et, bien sûr, de leur liberté. Et, en Amérique du Sud, Thomas Brignon explique comment l’importation d’animaux d’élevage à partir de l’Europe a amené un « chamboulement éthologique » (p. 265) des équilibres naturels d’origine.
De nos jours, nous suivons le vécu des vaches enragées : « le sort des bovins face à la rage rappelle à quel point les animaux domestiques dépendent de leurs maîtres bipèdes » (Nicolas Baron, p. 64). Éric Baratay analyse en détail le statut des populations d’animaux des zoos, ni vraiment sauvages, ni vraiment domestiqués, captifs en semi-liberté. Et lors de la première guerre mondiale, les innombrables chevaux ont partagé, involontairement, les souffrances et les agonies des soldats humains : « les chevaux criblés d’éclats s’affalent, poitrail ou abdomen ouvert, pattes agitées, se raidissant, yeux révulsés, gorge renâclant » (Baratay, p. 44). Sont aussi présentés l’entrée en ville des renards (Nicolas Baron), le retour des castors sur la Loire (Rémi Luglia) et le travail et la domestication de l’éléphant d’Asie (Nicolas Lainé).
Certains animaux sont même suffisamment bien connus pour pouvoir bénéficier de leur propre biographie, comme Bucéphale, le cheval d’Alexandre, « devenu pour Alexandre bien plus qu’un simple auxiliaire, un véritable compagnon d’armes » (Jérémy Clément, p. 238). Est aussi exemplaire le cas de la vie traumatique de la petite chimpanzé Meshie, conté par Baratay. Cette petite femelle est capturée en Afrique après la mise à mort de sa mère, adoptée ensuite par un couple humain qui la ramène en Occident et cherche à « l’humaniser » de manière maladroite, puis vendue à un jardin zoologique où « elle souffre d’une forte rupture en découvrant des hommes plus distants et des chimpanzés qu’elle a oubliés » (p. 256). La vie de Meshie qui « décède tôt, à 8 ans […] à l’âge de l’adolescence pour les congénères en nature » (p. 258) témoigne, de manière très vivante, de la brutalité des rapports avec les êtres humains.
Les historiens décrivent l’histoire avec toute l’objectivité qu’elle mérite. Qu’il soit toutefois permis à l’éthicien que je suis, de conclure le compte rendu de ce superbe ouvrage par les implications qu’il suggère en morale. La relation des vies des animaux, vues de l’intérieur du vécu animal, ne peut manquer de donner davantage de relief aux traitements souvent désastreux que notre espèce fait subir aux animaux. En ce sens, l’œuvre de Baratay et de ses collègues est une invitation à une démarche de respect de l’animal, qui intéresse particulièrement notre Fondation.
Georges Chapouthier