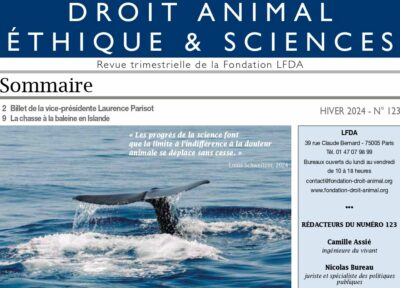Le jeudi 5 décembre 2024, l’Islande a autorisé la poursuite de la chasse à la baleine dans ses eaux pour les cinq prochaines années. Bien qu’il ne s’agisse que de deux baleiniers, cette décision s’inscrit dans un contexte plus large de contestations de la chasse à la baleine, de préoccupations pour le bien-être animal et la disparition de la biodiversité. La récente arrestation, puis libération, de Paul Watson, fondateur de Sea Shepherd, en lien avec sa lutte contre la chasse à la baleine pratiquée par le Japon dans l’océan Austral,[1] est un autre exemple illustrant la cristallisation de ces tensions.

Quel droit concernant la chasse à la baleine ?
La chasse à la baleine est régulée par la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine (dont le respect est assuré par la Commission baleinière), adoptée en 1946 et entrée en vigueur en 1948. Elle est complétée en 1982 par un moratoire qui interdit l’exploitation commerciale des baleines, toutes espèces confondues, à partir de 1985-1986. L’Islande est l’un des rares pays au monde, avec la Norvège et le Japon, à toujours permettre la chasse à la baleine dans ses eaux. L’Islande est en effet l’un des membres fondateurs de la Commission baleinière, mais la quitte en 1982 à cause du moratoire. Elle change toutefois d’avis et rejoint à nouveau la Commission en 2002, tout en émettant un droit de réserve sur le moratoire, ce qui signifie qu’il ne s’applique pas à l’Islande. La chasse commerciale à la baleine y reprend donc en 2006. Il existe une exception au moratoire pour les populations indigènes pratiquant une chasse de subsistance s’inscrivant dans des pratiques culturelles, notamment dans l’Arctique, mais l’Islande ne fait pas partie de cette exception, d’où sa réserve sur le sujet.
Lire aussi : La chasse à la baleine persiste
Bien-être animal et sentience
La chasse à la baleine en Islande avait été interrompue en 2023 à cause de méthodes de chasse non conformes aux normes internationales. L’utilisation de harpons explosifs entraînait notamment l’agonie des baleines, qui pouvaient parfois mourir au bout de deux heures. Lors de la reprise de la chasse fin 2023, près d’un tiers des baleines ne mourrait toujours pas immédiatement, et leur agonie durait parfois jusqu’à 35 minutes selon un rapport de plusieurs ONG en 2024 [PDF]. Une baleine avait même été poursuivie pendant cinq heures par un navire, un harpon planté dans le dos, sans que les chasseurs ne réussissent à l’attraper. Cela signifie que l’Islande agit non seulement à l’encontre des volontés de la Commission baleinière concernant les méthodes de chasse considérées comme plus respectueuses (dans le sens d’une minimisation des souffrances), mais aussi de ses propres régulations en matière de bien-être animal (loi islandaise sur le bien-être animal, n° 55 – PDF).
Une opinion publique défavorable
En outre, les baleines sont composées d’espèces largement reconnues comme intelligentes et sentientes, ce qui contribue à l’opposition publique à la chasse à la baleine. En 2023, 51 % de la population islandaise était opposée à la chasse à la baleine, contre 42 % en 2019. En comparaison, seulement 18 % de la population japonaise se dit opposée à la chasse à la baleine. Ainsi, bien que l’Islande ait longtemps dépendu économiquement de la chasse à la baleine, ce n’est plus le cas aujourd’hui. L’économie islandaise actuelle repose en effet sur le tourisme, et la viande de baleine issue de la chasse est principalement exportée au Japon. Toutefois, la viande de baleine apparaît comme une spécialité locale et est donc également consommée par les touristes étrangers visitant l’Islande. Seulement 2 % de la population islandaise consomme de la viande de baleine.
Science et protection de l’environnement
Concernant la chasse à la baleine, le gouvernement islandais se justifie en indiquant que les quotas de chasse sont basés sur la science et les recommandations d’institutions islandaises de recherche, comme le Marine and Freshwater Research Institute. Le gouvernement affirme par ailleurs que la chasse à la baleine se fonde sur le principe de précaution ainsi qu’une utilisation durable des ressources. Compte tenu des débats actuels sur le bien-être animal, il est important de se demander si les limites posées par les scientifiques sont véritablement les meilleures justifications pour la chasse à la baleine, ou si des considérations éthiques et morales ne devraient pas également peser dans les discours.
Lire aussi : Sauvons les baleines disent les économistes
Autres menaces
Malgré le moratoire, le rorqual commun, qui est inclus dans le permis de chasse islandais, est considéré comme vulnérable par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Cela s’explique non seulement par la chasse, mais aussi par les filets de pêche destinés à d’autres espèces et les collisions avec des bateaux. Ainsi, interdire la chasse permettrait d’alléger les pressions qui pèsent sur les baleines, mais ne résoudrait pas totalement les problèmes de conservation de l’espèce. La chasse à la baleine est une pression écologique d’un autre temps envers des espèces déjà menacées par d’autres problèmes, tels que le changement climatique, alors que les baleines contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes marins et à la capture de carbone dans les océans.
Jordane Liebeaux