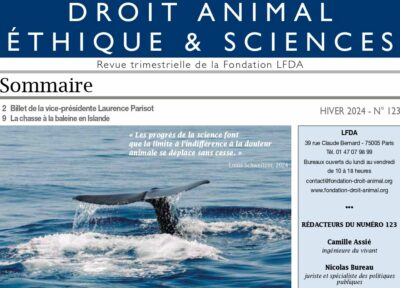L’article 515-14 du code civil dispose que « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens ». Cette disposition, issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures fête ses donc ses dix ans en février 2025. Mais comment une telle disposition s’est-elle retrouvée dans un tel projet de loi ?

Un jalon historique conquis difficilement
L’insertion de la sensibilité des animaux dans le code civil était un combat de longue date des juristes qui voulaient faire progresser les droits des animaux, ainsi que des structures telles que la LFDA. En 2005, un rapport demandé par le ministre de la Justice à Mme Suzanne Antoine, présidente de chambre honoraire à la cour d’appel de Paris et trésorière de la LFDA, examinait la place des animaux dans la législation française et proposait des réformes pour mieux refléter leur statut d’êtres vivants doués de sensibilité. À l’époque, les animaux étaient encore juridiquement considérés comme des biens dans le code civil, bien que leur sensibilité fût reconnue dans le code rural (depuis 1976) et dans certaines dispositions du code pénal. Cette situation créait des incohérences qui ne correspondaient plus aux attentes d’une société de plus en plus soucieuse du bien-être animal.
Suzanne Antoine soulignait que le cadre législatif en vigueur était dépassé et nécessitait une réforme ambitieuse. L’un des principaux problèmes identifiés résidait dans la contradiction entre les différents textes juridiques. Tandis que les lois pénales sanctionnaient déjà les mauvais traitements envers les animaux domestiques, le code civil continuait de les assimiler à des biens. Cette ambiguïté juridique compliquait leur protection et nuisait à la cohérence des politiques publiques.
Les propositions du rapport Antoine
Pour répondre à ces défis, plusieurs propositions de réforme avaient été avancées. La création d’une catégorie juridique spécifique pour les animaux figurait parmi les recommandations majeures. Il s’agissait de reconnaître que les animaux n’étaient ni des biens ni des personnes, mais qu’ils méritaient un statut particulier qui tînt compte de leur sensibilité et de leurs besoins spécifiques. Une telle réforme aurait offert une base légale pour encadrer les droits et devoirs des propriétaires tout en garantissant une protection renforcée des animaux.
Une autre piste évoquée consistait à modifier le code civil afin d’y intégrer explicitement la définition des animaux comme êtres vivants doués de sensibilité. Cette reconnaissance symbolique aurait également eu des effets pratiques, en harmonisant le droit civil avec les exigences éthiques et les attentes sociales. Il était également proposé de revoir certaines règles liées à l’appropriation des animaux, pour refléter leur statut particulier sans bouleverser les régimes existants.
Toutefois, ces propositions n’étaient pas sans susciter de débats. Les secteurs agricole et scientifique, notamment, exprimaient des inquiétudes quant aux impacts potentiels de ces réformes sur leurs pratiques. Les éleveurs craignaient des contraintes supplémentaires, tandis que les chercheurs redoutaient une limitation des expérimentations animales. Le rapport insistait donc sur la nécessité de trouver un équilibre entre les attentes sociales, les impératifs économiques et les contraintes légales, afin de garantir l’acceptation des réformes.
Le rapport relevait également les avancées réalisées dans d’autres pays européens. En Suisse, en Allemagne et en Autriche, des réformes similaires avaient été menées pour retirer les animaux de la catégorie des biens. Ces pays avaient introduit des dispositions qui, tout en continuant à protéger les intérêts des humains qui travaillent avec des animaux, reconnaissaient les animaux comme des êtres sensibles distincts des objets inanimés. Ces exemples montraient qu’il était possible de concilier une réforme juridique ambitieuse avec les contraintes pratiques des secteurs concernés, comme l’agriculture ou la recherche scientifique.
Consultée dans le cadre de ce rapport, la LFDA dénonçait elle aussi l’absence de reconnaissance explicite de la spécificité des animaux dans le droit positif français. Bien que la modification de l’article 528 par la loi du 6 janvier 1999 représentât une avancée, elle estimait qu’elle n’appréhendait pas la caractéristique essentielle des animaux, à savoir leur sensibilité. Cette approche restait en décalage avec d’autres cadres législatifs comme le code rural, le code pénal ou le Traité d’Amsterdam, qui intégraient déjà les notions de bien-être animal et de protection basée sur leur nature sensible.
La LFDA proposait une refonte juridique visant à définir clairement les animaux dans le code civil. Elle considérait qu’une définition précise était indispensable pour établir un régime juridique cohérent. Selon ses recommandations, l’animal aurait dû être explicitement décrit comme un « être vivant doué de sensibilité » et placé dans un chapitre distinct, séparé de celui des biens. Cette distinction aurait permis de reconnaître ses droits au bien-être, au respect de son intégrité et à une protection contre la souffrance. Si l’animal devait néanmoins rester dans la catégorie des biens, la LFDA préconisait de lui attribuer le statut de « bien protégé », en accord avec sa nature sensible.
Parmi les mesures les plus ambitieuses envisagées, la LFDA évoquait l’idée d’attribuer une « personnalité juridique » aux animaux. Bien qu’elle estimât que cette réforme était prématurée dans le contexte juridique et social de l’époque, elle considérait qu’une telle évolution aurait permis de défendre des droits fondamentaux, comme celui de ne pas subir de souffrance infligée par l’homme. Cette personnalisation aurait pu s’inspirer du modèle des personnes morales, avec des mécanismes de représentation adaptés.
La LFDA insistait également sur la nécessité d’inclure les animaux sauvages dans cette réflexion. Elle regrettait que les animaux sauvages libres soient encore perçus comme des « biens sans maître » (res nullius) et ne soient donc pas protégés. Cela aurait permis de reconnaître leur sensibilité tout en les intégrant dans le cadre du droit de l’environnement, et aurait ainsi unifié le régime juridique des animaux, qu’ils soient domestiques ou sauvages, corrigeant une incohérence à la fois scientifique et éthique.
Entre symboles et résistances : l’incertaine reconnaissance de la sensibilité animale
Quelques semaines après la présentation de ce rapport au ministre de la Justice, Dominique Perben, une dissolution de l’Assemblée nationale entraîna l’arrivée d’un nouveau ministre de la Justice, Pascal Clément, qui choisit de mettre le dossier de côté. Le temps politique étant un temps long, il fallut attendre un projet de loi de 2013 pour que le sujet revienne sur le tapis, par le truchement d’amendements à un texte sur la simplification du droit.
L’amendement n° 59, déposé à l’occasion de la première lecture à l’Assemblée nationale, proposait d’ajouter la disposition suivante dans le code civil : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens corporels ». Un sous-amendement, provenant d’autres parlementaires, entendait compléter celui-ci en insistant sur le besoin de faire bénéficier les animaux de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et d’assurer leur bientraitance. Un autre proposait de tirer les conséquences de cette reconnaissance en supprimant la dérogation dont bénéficie la corrida.
Si les sous-amendements seront rejetés, l’amendement n° 59, lui, sera adopté. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, déclarera en séance publique : « Nous ne pouvons raisonnablement qu’introduire dans le code civil une définition des animaux et la reconnaissance de leur sensibilité. C’est déjà une réelle innovation en ce qu’elle permet de les distinguer des biens. […] C’est un acte qui a son poids, sa signification et surtout ses conséquences. Introduire les animaux en tant qu’êtres sensibles dans le code civil est loin d’être banal ; ce n’est pas un geste anodin ».
Si, politiquement, il est certain que cette adoption fut un acte fort, on pouvait déjà se poser la question de ses effets juridiques. La députée Geneviève Gaillard, alors présidente du groupe d’étude Protection des animaux, soulignait notamment que l’amendement restait purement symbolique et sans effet réel sur leur condition. Il ne modifiait en rien le régime des biens corporels applicable aux animaux, qui continueraient à être traités comme des propriétés soumises au droit civil, notamment au droit de propriété.
« Cette initiative quoiqu’apparemment louable ne relève en fait que du pur symbole et ne marque aucune avancée concrète dans notre combat pour l’évolution du statut juridique de l’animal puisque en effet les porteurs de cet amendement n’avaient nulle ambition d’étendre le caractère d’être sensible à tous les animaux, les animaux sauvages restant des êtres insensibles (sic), et surtout aucune envie d’y attacher des effets juridiques restreignant un tant soit peu la suprématie actuelle du code civil et du droit des biens, et, en particulier, celle du droit de propriété sur tous les autres régimes de protection des animaux contenus dans le code rural et le code de l’environnement. »
Geneviève Gaillard, avec d’autres membres du groupe d’études, comme Laurence Abeille, travaillait d’ailleurs déjà sur une proposition de loi plus ambitieuse. Si elle avait été adoptée, le code civil aurait eu article 515-14 bien différent : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Ils doivent bénéficier de conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et assurant leur bien-être/bien-traitance (sic).»
Dans un rapport portant sur le projet de loi, on apprend que la FNSEA était vertement opposée à cette évolution, et voulait que les animaux restent des biens comme les autres. On lit également qu’un député souhaitait ne « pas ouvrir la boîte de Pandore », craignait qu’on s’attaque ensuite à la chasse, et voulait sécuriser la situation des éleveurs et des abattoirs. En réponse, Jean Glavany, ancien ministre de l’Agriculture et initiateur de l’amendement n° 59, ironisait : « Je ne savais pas que la FNSEA était habilitée à légiférer en commission mixte paritaire. »
Lors des débats successifs, d’autres amendements seront proposés pour compléter ou supprimer cette reconnaissance de la sensibilité des animaux dans le code civil, mais sans succès. Le texte est adopté le 28 janvier et promulgué le 16 février 2015.
Nicolas Bureau